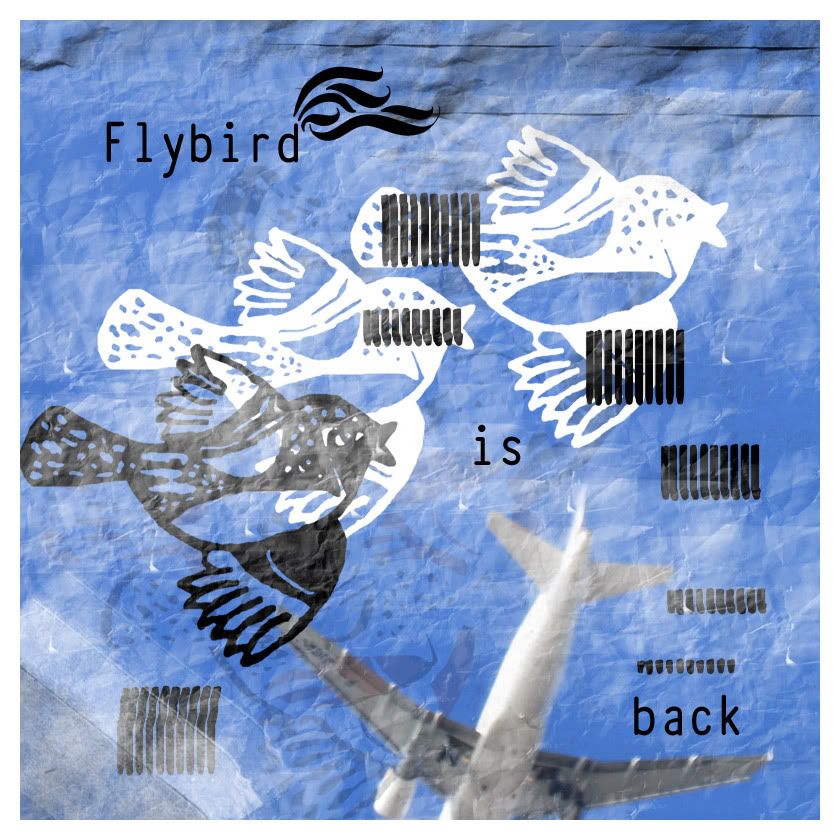Tuesday, December 25, 2012
Saturday, December 8, 2012
La philosophie du porc
C'est sous la conjonction de la terreur politique, de la faiblesse des élites et de la séduction du profit que le monde des intérêts et des possessions matérielles, qui s'est peu à peu développé à partir des années 1980, a totalement remplacé les rêves spirituels et les fondations morales comme éléments dominants de l'âme. La philosophie du porc, caractérisée par la polarisation sur l'économie et la primauté de l'intérêt, a entamé, sous prétexte d'introspection, une critique du radicalisme et l'élimination de l'idéalisme. La froideur de la "localisation" et du retour à l'académique a remplacé l'enthousiasme pour les idées libérales ; et même l'extrême moralisme de ce que l'on a qualifié de "littérature de résistance", dont l'objectif est de résister à la culture de masse, tout, sans exception, a pour prémisse la collaboration avec le système existant. Que ce soit du point de vue de la renaissance ou de la reconstruction de la culture nationale, ou du point de vue du renforcement ou de l'élévation de l'universalisme et de la nature humaine, la Chine des années 1990 est affreuse et pourrie, et la médiocrité en est devenue le symbole évident.
Liu Xiaobo, La philosophie du porc et autres essais
Thursday, December 6, 2012
Qu'est-ce que la bêtise ?
Quelqu'un qui entreprend de parler de la bêtise court aujourd'hui le risque de subir quelque avanie : on peut l'accuser de prétention, ou de vouloir troubler le cours de l'évolution historique. J'ai écrit moi-même, il y a quelques années déjà : « Si la bêtise ne ressemblait pas à s'y méprendre au progrès, au talent, à l'espoir et au perfectionnement, personne ne voudrait être bête. » C'était en 1931 ; et nul ne s'avisera de contester que le monde, depuis, n'ait vu un certain nombre de progrès et de perfectionnements ! Ainsi est-il devenu peu à peu impossible d'ajourner la question : « Qu'est-ce, au juste, que la bêtise ? » [...] Nous ne pouvons nous faire quelque idée du pouvoir, énorme autant qu'éhonté, de la bêtise sur nous, en voyant l'aimable conspiration de surprise qui accueille généralement celui qui prétend, alors qu'on lui faisait confiance, évoquer ce monstre par son nom. J'ai commencé par en faire sur moi l'expérience ; je n'ai pas tardé à en avoir la confirmation historique le jour où, parti à la recherche de prédécesseurs dans l'étude de la bêtise — dont je n'ai rencontré qu'un petit nombre d'ailleurs, les sages préférant apparemment traiter de la sagesse ! —, j'ai reçu d'un érudit de mes amis le texte d'une conférence de 1868 dont l'auteur est Jon. Ed. Erdman, élève de Hegel et professeur à Halle. Cette conférence, intitulée De la bêtise, commence en effet par évoquer les rires qui avaient salué son annonce ; et depuis je sais que même un hégélien peut y être exposé, je suis convaincu qu'il y a quelque chose de particulier dans cette attitude de l'homme envers celui qui veut traiter de la bêtise ; et la certitude d'avoir ainsi provoqué un pouvoir psychologique puissant et profondément ambigu me remplit de perplexité. Je préfère donc avouer ma faiblesse devant ce problème : c'est que j'ignore ce quelle est. Je n'ai pas découvert de théorie de la bêtise à l'aide de laquelle je pourrais entreprendre de sauver le monde ; je n'ai même pas trouvé, à l'intérieur des limites de la réserve scientifique, un seul chercheur qui en ai fait son objet, pas même le témoignage d'une unanimité qui se serait établie tant bien que mal à son sujet dans l'analyse de phénomènes analogues. Peut-être cela tient-il à mon manque d'information ; mais il est plus probable que la question : « Qu'est-ce que la bêtise ? » est aussi peu naturelle à la pensée moderne que la question : « Qu'est-ce que le beau, ou le bien, ou l’électricité ? ».
Robert Musil, De la bêtise, conférence de Vienne, 11 mars 1937.
Effigie du raté
Ayant tout acte en horreur, il se répète à lui-même : « Le mouvement, quelle sottise ! » Ce ne sont pas tant les événements qui l'irritent que l'idée d'y prendre part ; et il ne s'agite que pour s'en détourner. Ses ricanements ont dévasté la vie avant qu'il n'en ait épuisé la sève. C'est un Ecclésiaste de carrefour, qui puise dans l'universelle insignifiance une excuse à ses défaites. Soucieux de trouver sans importance quoi que ce soit, il y réussit aisément, les évidences étant en foule de son côté. Dans la bataille des arguments, il est toujours vainqueur, comme il est toujours vaincu dans l'action : il a "raison", il rejette tout et tout le rejette. Il a compris prématurément ce qu'il ne faut pas comprendre pour vivre et comme son talent était trop éclairé sur ses propres fonctions, il l'a gaspillé de peur qu'il ne s'écoulât dans la niaiserie d'une oeuvre. Portant l'image de ce qu'il eût pu être comme un stigmate et comme un nimbe, il rougit et se flatte de l'excellence de sa stérilité, à jamais étranger aux séductions naïves, seul affranchi parmi les ilotes du Temps. Il extrait sa liberté de l'immensité de ses inaccomplissements ; c'est un dieu infini et pitoyable qu'aucune création ne limite, qu'aucune créature n'adore, et que personne n'épargne. Le mépris qu'il a déversé sur les autres, les autres le lui rendent. Il n'expie que les actes qu'il n'a pas effectués, dont pourtant le nombre excède le calcul de son orgueil meurtri. Mais à la fin, en guise de consolation, et au bout d'une vie sans titres, il porte son inutilité comme une couronne.
« A quoi bon ? » adage du Raté, d'un complaisant de la mort... Quel stimulant lorsqu'on commence à en subir la hantise ! Car la mort, avant de trop nous y appesantir, nous enrichit, nos forces s'accroissent à son contact ; puis, elle exerce sur nous son oeuvre de destruction. L'évidence de l'inutilité de tout effort, et cette sensation de cadavre futur s'érigeant déjà dans le présent, et emplissant l'horizon du temps, finissent par engourdir nos idées, nos espoirs et nos muscles, de sorte que le surcroît d'élan suscité par la toute récente obsession, se convertit — lorsque celle-ci s'est implantée irrévocablement dans l'esprit — en une stagnation de notre vitalité. Ainsi cette obsession nous incite à devenir tout et rien. Normalement elle devrait nous mettre devant le seul choix possible : le couvent ou le cabaret. Mais, quand nous ne pouvons la fuir ni par l'éternité ni par les plaisirs, quand, harcelés au milieu de notre vie, nous sommes aussi loin du ciel que de la vulgarité, elle nous transforme en cette espèce de héros décomposés qui promettent tout et n'accomplissent rien : oisifs s'essoufflant dans le Vide, charognes verticales, dont la seule activité se réduit à penser qu'ils cesseront d'être...
Emil Cioran, Syllogismes de l'amertume
Thursday, November 29, 2012
Ce que nous appelons symbole
Ce que nous appelons symbole est un terme, un nom ou une image, qui même lorsqu’ils nous sont familiers dans la vie quotidienne, possèdent néanmoins des implications, qui s’ajoutent à leur signification conventionnelle et évidente. Le symbole implique quelque chose de vague, d’inconnu ou de caché pour nous… Lorsque l’esprit entreprend l’exploration d’un symbole, il est amené à des idées qui se situent au-delà de ce que notre raison peut saisir. L’image de la roue peut, par exemple, nous suggérer le concept d’un soleil divin, mais à ce point notre raison est obligée de se déclarer incompétente, car l’homme est incapable de définir un être divin… C’est parce que d’innombrables choses se situent au-delà de l’entendement humain que nous utilisons constamment des termes symboliques pour représenter des concepts que nous ne pouvons ni définir ni comprendre pleinement… Mais cet usage conscient que nous faisons des symboles n’est qu’un aspect d’un fait psychologique de grande importance : car l’homme crée aussi des symboles de façon inconsciente et spontanée pour tenter d’exprimer l’invisible et l’ineffable.
Carl Gustav Jung
Wednesday, November 21, 2012
Actes respectueux ou actes de respect
Au XIXe siècle, la majorité matrimoniale était de 25 ans pour un homme et de 21 ans pour une femme.
Même plus âgés, les jeunes gens qui désiraient se marier pouvaient le faire sans le consentement de leurs parents, mais après avoir respecté la formalité suivante : ils devaient notifier leur projet aux parents par un acte notarié appelé « acte respectueux » ou « acte de respect ».
En cas de refus des parents, la demande devait être renouvelée deux fois. Si le garçon avait plus de 30 ans ou si la fille avait plus de 25 ans, un seul acte respectueux suffisait. Le mariage pouvait avoir lieu, un mois après le refus des parents.
Ces mesures ont été progressivement assouplies à la fin du XIXe siècle et ont été définitivement supprimées en 1933.
Même plus âgés, les jeunes gens qui désiraient se marier pouvaient le faire sans le consentement de leurs parents, mais après avoir respecté la formalité suivante : ils devaient notifier leur projet aux parents par un acte notarié appelé « acte respectueux » ou « acte de respect ».
En cas de refus des parents, la demande devait être renouvelée deux fois. Si le garçon avait plus de 30 ans ou si la fille avait plus de 25 ans, un seul acte respectueux suffisait. Le mariage pouvait avoir lieu, un mois après le refus des parents.
Ces mesures ont été progressivement assouplies à la fin du XIXe siècle et ont été définitivement supprimées en 1933.
Tuesday, November 20, 2012
Friday, November 16, 2012
L’œuvre de Deleuze
L’œuvre de Deleuze, on l’aime ou ne l’aime pas, on l’aime de façon un peu folle ou pour le moins exaltée ou on la déteste de façon tout aussi folle et exaltée, même s’il s’agit d’une exaltation rentrée. On peut également ignorer Deleuze, ce qui est malgré tout le cas du plus grand nombre. Mais c’est évidemment dommage. Pour ma part, lorsque j’ai commencé de le lire, il ne m’a plus été possible de m’arrêter. C’est un peu comme dans l’extrait du roman de Malamud que Deleuze cite au début de son petit livre sur Spinoza. Comme l’homme de Kiev découvrant Spinoza, en lisant Deleuze je ne comprenais pas tout, presque rien au début il faut bien le reconnaître, mais, effectivement, c’était comme si j’enfourchais un balai de sorcière, ou plus précisément comme si, sans comprendre, je comprenais, comme si j’avais la certitude que la compréhension précise ou de détail viendrait ensuite, alors même que tout ce que je lisais était clair et évident pour moi, à condition de ne pas s’arrêter, de continuer de lire, toujours plus et toujours plus loin. Un mouvement qui ne m’a plus quitté, qui m’a permis de relire ce que j’avais lu, de le comprendre un peu moins mal ; mais qui explique également le désarroi que j’ai éprouvé, comme beaucoup d’autres j’imagine, lorsque j’ai appris la mort de Deleuze, un désarroi en grande partie égoïste. Ce qui m’accablait c’était la certitude que je ne lirais plus jamais un nouveau livre de Deleuze.
Daniel Colson, Deleuze, Guattari et l’anarchie
Daniel Colson, Deleuze, Guattari et l’anarchie
Tuesday, November 13, 2012
Shucking and jiving
Shuck and jive se réfère à l'origine à des paroles et des actions trompeuses que les Africains-Américains utilisaient pour duper les Américains européens racistes ayant du pouvoir, à la fois pendant l'esclavage et après cette période. L'expression était couramment utilisée dans les années 1920, mais pourrait remonter à une époque plus lointaine. Shucking and jiving était une tactique de survie et de résistance. Un esclave, par exemple, pouvait dire avec enthousiasme : “bien sûr, Maître”, sans avoir réellement l’intention d'obéir. Ou bien un Africain-Américain pouvait faire semblant de travailler dur sur une tâche qu'on lui avait assignée, mais travaillait en réalité uniquement lorsqu'il était observé. Ces deux situations sont des cas de shucking and jiving.
Thursday, October 25, 2012
Monday, October 15, 2012
Une typologie du don
Fréderic Lordon ébauche une typologie des différents types de don :
— Le don de pacification : il s’établit pour réprimer la violence originelle des conatus. La société n’est faite que de ces conatus et de leur régulation. La pacification est donc comme une guerre menée à la guerre : les pulsions prédatrices doivent être domestiquées et tournées en leur contraire. « C’est du prendre que vient le danger, c’est lui qu’il faut impérativement entourer de “toutes sortes de précautions archaïques”, c’est sa violence intrinsèque qu’il faut neutraliser par une mise en forme “sans aucune faute” ». Au lieu de dépenser ses forces à piller et tuer son voisin, on apprendra au contraire à se montrer généreux envers lui. « Au moment même où le geste pronateur se révèle comme le mouvement le plus brut du conatus, il s’annonce également comme le péril social par excellence dès lors qu’il menace de prendre des mains d’autrui ce qu’il ne peut pas prendre à la nature ». Le combat de l’homme contre l’homme est transformé en une joute agonale, selon le jeu réglé du don / contre-don : tu m’offres énormément et je t’en remercie avec gratitude. Mais je saurai me montrer encore plus généreux que toi et j’en acquerrai un prestige supérieur. « Tant que les appareils de la pacification fondamentale sont encore trop fragiles et que la libération des conatus sous la forme utilitaire-matérielle ne cesse d’emporter le risque de la décomposition violente, l’échange économique intéressé est voué à la stigmatisation et à l’indignité. A contrario, la grandeur des pratiques de l’échange symbolique est attestée par une forme de renoncement consenti aux yeux de tous, le sacrifice des élans spontanés de son conatus manifestant un haut degré de maîtrise de soi — c’est-à-dire de ses pulsions antisociales — et de considération pour les exigences de la cohésion collective ». Cette première forme du don est bien une mise en forme, qui exige un respect impeccable du cérémoniel de l’échange, de manière à tenir à l’écart les choses et les appétits qu’elles excitent.
— Le don de sociation : La menace de l’anarchie généralisée étant écartée, la société acquiert une plus grande stabilité, qui permet une plus grande complexité des échanges. Ce deuxième type de don permet d’entretenir de bonnes relations avec ses "amis". Il maintient des relations d’obligations réciproques et inclue-même les pratiques de celui qui corrompt, soudoie, stipendie. Le don, loin d’être pur, est intéressé à maintenir l’intérêt du donateur, par une pratique qui m’attache la reconnaissance d’autrui, et qui se fait passer pour de la pure libéralité.
— Le don unilatéral : Il est le plus proche du modèle idéal de don pur, gratuit, fait par pure générosité. Il a pour effet d’accroître son estime. Il est plus raffiné, plus civilisé, plus beau sans doute, mais pas moins intéressé, car même l’homme le plus généreux aime jouir de l’estime des autres et ressentir sa puissance dans l’acte même d’offrande. Il est en un sens le plus trompeur car il est celui qui peut le plus passer pour une donation sans réciproque.
— Le don de pacification : il s’établit pour réprimer la violence originelle des conatus. La société n’est faite que de ces conatus et de leur régulation. La pacification est donc comme une guerre menée à la guerre : les pulsions prédatrices doivent être domestiquées et tournées en leur contraire. « C’est du prendre que vient le danger, c’est lui qu’il faut impérativement entourer de “toutes sortes de précautions archaïques”, c’est sa violence intrinsèque qu’il faut neutraliser par une mise en forme “sans aucune faute” ». Au lieu de dépenser ses forces à piller et tuer son voisin, on apprendra au contraire à se montrer généreux envers lui. « Au moment même où le geste pronateur se révèle comme le mouvement le plus brut du conatus, il s’annonce également comme le péril social par excellence dès lors qu’il menace de prendre des mains d’autrui ce qu’il ne peut pas prendre à la nature ». Le combat de l’homme contre l’homme est transformé en une joute agonale, selon le jeu réglé du don / contre-don : tu m’offres énormément et je t’en remercie avec gratitude. Mais je saurai me montrer encore plus généreux que toi et j’en acquerrai un prestige supérieur. « Tant que les appareils de la pacification fondamentale sont encore trop fragiles et que la libération des conatus sous la forme utilitaire-matérielle ne cesse d’emporter le risque de la décomposition violente, l’échange économique intéressé est voué à la stigmatisation et à l’indignité. A contrario, la grandeur des pratiques de l’échange symbolique est attestée par une forme de renoncement consenti aux yeux de tous, le sacrifice des élans spontanés de son conatus manifestant un haut degré de maîtrise de soi — c’est-à-dire de ses pulsions antisociales — et de considération pour les exigences de la cohésion collective ». Cette première forme du don est bien une mise en forme, qui exige un respect impeccable du cérémoniel de l’échange, de manière à tenir à l’écart les choses et les appétits qu’elles excitent.
— Le don de sociation : La menace de l’anarchie généralisée étant écartée, la société acquiert une plus grande stabilité, qui permet une plus grande complexité des échanges. Ce deuxième type de don permet d’entretenir de bonnes relations avec ses "amis". Il maintient des relations d’obligations réciproques et inclue-même les pratiques de celui qui corrompt, soudoie, stipendie. Le don, loin d’être pur, est intéressé à maintenir l’intérêt du donateur, par une pratique qui m’attache la reconnaissance d’autrui, et qui se fait passer pour de la pure libéralité.
— Le don unilatéral : Il est le plus proche du modèle idéal de don pur, gratuit, fait par pure générosité. Il a pour effet d’accroître son estime. Il est plus raffiné, plus civilisé, plus beau sans doute, mais pas moins intéressé, car même l’homme le plus généreux aime jouir de l’estime des autres et ressentir sa puissance dans l’acte même d’offrande. Il est en un sens le plus trompeur car il est celui qui peut le plus passer pour une donation sans réciproque.
Le don/contre-don
Le don/contre-don est l’une de ces codifications encore tout empreinte de la terreur archaïque qu’inspirent les pronations sans frein. C’est pourquoi il fait le choix de la prohibition et, barrant la prise, n’autorise que la réception - "ne prends rien qui ne t’ait été donné par autrui" est sa maxime civilisationnelle. Sans doute l’un des premiers modes de régulation de la circulation des choses, le don/contre-don n’est que le commencement d’une trajectoire historique qui va inventer bien d’autres mises en forme du prendre. C’est bien sous ce rapport et dans cette perspective qu’il faut replacer l’émergence spécifique de l’échange économique, à propos duquel Mauss, d’une certaine manière, nous invite à nous étonner à nouveau de ce qui ne nous étonne plus depuis longtemps : l’achat est un prendre, mais dont les sociétés modernes semblent avoir oublié toute la part de violence.
Frédéric Lordon, L’intérêt souverain
Frédéric Lordon, L’intérêt souverain
Friday, October 5, 2012
Journalistes, nouveaux pauvres
On perçoit actuellement dans le journalisme les conséquences d’une évolution qui affecte plus largement une grande partie du tertiaire et tout particulièrement le secteur de la production et de la diffusion des biens symboliques, évolution caractérisée par l’émergence et le développement au sein des classes moyennes d’un « prolétariat » de type nouveau, comparable à bien des égards à l’ancien prolétariat industriel, et en même temps très différent parce que les nouveaux manœuvres, ouvriers spécialisés et autres « nouveaux pauvres » de la production symbolique sont porteurs de propriétés (origines sociales, capital culturel, dispositions, etc.) grâce auxquelles ils peuvent faire illusion, aux yeux des autres et à leurs propres yeux, et continuer à tourner indéfiniment en rond dans les contradictions inhérentes à leur position de dominants (très) dominés, à la fois victimes malheureuses, souffre-douleur révoltés et complices consentants de l’exploitation qu’ils subissent.
Alain Accardo
Alain Accardo
Monday, October 1, 2012
La compétition sur le marché amoureux
Il y a une différence fondamentale entre les sociétés où le statut, la position sociale sont connus d’avance et relativement non négociables et celles ou l’identité sociale est à faire. Dans le premier cas, l’identité est inscrite dans une position sociale et la vie psychique, intérieure, est alignée sur cette identité et ce statut. On parait ce que l’on est, et on est ce que l’on parait. Or, la modernité ça veut dire une séparation entre statut social et rapport à soi, entre position sociale et identité. Ça veut dire que ce que l’on appelle “le sentiment de sa valeur” devient instable, négociable, à prouver et a acquérir. Ça veut donc dire que le sentiment d’insécurité sur sa propre valeur devient permanent, inscrit si je puis dire dans les rapports sociaux.
Deuxième élément : la transformation de l’écologie du choix amoureux fait que tout le monde est en compétition avec tout le monde. Les femmes belles sont en compétition avec les femmes intelligentes ; les catholiques avec les juives ; les cools avec les BCBG. C’est très diffèrent de la situation jusqu’au XIXème siècle, où les échantillons restent limités et régulés. La situation de compétition sur le marché amoureux est devenue très forte, peut-être encore plus forte que la compétition sur le marché du travail. Tout ça crée une incertitude sur sa valeur et un déficit de reconnaissance sociale (la reconnaissance c’est ce qui nous assure de notre valeur).
Etre dans une relation amoureuse, ça veut dire arrêter la compétition, avoir été élu, choisi parmi les autres. La relation amoureuse peut donc prodiguer ce déficit de reconnaissance qui manque de façon chronique et structurale à la plupart d’entre nous.
Eva Illouz, Pourquoi l'amour fait mal : l'experience amoureuse dans la modernité
Tuesday, September 25, 2012
Une barrière symbolique
Aujourd’hui, la fracture politique ne passe plus par la gauche et la droite, mais entre ceux qui ont les moyens de construire une barrière symbolique entre soi et les autres, et ceux qui ne les ont pas.
Dans les quartiers populaires des grandes villes, l’évitement du collège est souvent la norme pour les catégories supérieures. Les bobos parisiens ont les moyens d’ériger des frontières en douceur, un "évitement républicain" en quelque sorte : ils savent se débrouiller pour ne pas mettre leurs gamins dans la même école que ceux des familles tchétchènes ou africaines. Un enseignant sur cinq contourne la carte scolaire. Pour les ouvriers ou les paysans, le taux passe à un sur vingt. Quand il n’y a pas d’autre fuite possible, la tentation est de demander à quelqu’un, qu’on suppose politiquement fort, de dresser pour vous cette barrière symbolique. A l’arrivée, on peut quand même se poser la question : qui est dans la radicalité ? Le salarié à temps partiel qui vote FN ? Ou le bobo parisien qui fait de l’évitement scolaire ?
Christophe Guilluy, géographe
Dans les quartiers populaires des grandes villes, l’évitement du collège est souvent la norme pour les catégories supérieures. Les bobos parisiens ont les moyens d’ériger des frontières en douceur, un "évitement républicain" en quelque sorte : ils savent se débrouiller pour ne pas mettre leurs gamins dans la même école que ceux des familles tchétchènes ou africaines. Un enseignant sur cinq contourne la carte scolaire. Pour les ouvriers ou les paysans, le taux passe à un sur vingt. Quand il n’y a pas d’autre fuite possible, la tentation est de demander à quelqu’un, qu’on suppose politiquement fort, de dresser pour vous cette barrière symbolique. A l’arrivée, on peut quand même se poser la question : qui est dans la radicalité ? Le salarié à temps partiel qui vote FN ? Ou le bobo parisien qui fait de l’évitement scolaire ?
Christophe Guilluy, géographe
Sunday, September 23, 2012
L’eutrapélie
L’eutrapélie est un mot que j’ai été cherché à dessein dans le grec d’Aristote et le latin scolastique de Thomas d'Aquin, et qui a remporté un certain succès de surprise chez mes lecteurs. Ce mot savant désigne en fait une disposition d’humeur heureuse, bienveillante, souriante qui répand dans la conversation et les relations sociales la détente, la gaîté, l’esprit de jeu et de joie. L’entrée de cette notion hellénique dans le vocabulaire de la théologie morale chrétienne au XIIIe siècle a coïncidé avec l’apparition du sourire sur les traits des Vierges à l’enfant ou des Christs de la sculpture gothique. La joie contagieuse commence à devenir une vertu, et la tristesse cesse d’être tenue pour l’attitude convenable au chrétien. L’humanisme de la Renaissance, qui réhabilite l’otium, laïcisera cet esprit de joie. Tout un aspect des arts de la Renaissance se propose de favoriser cette bonne humeur, fille de l’équilibre intérieur, et mère du bonheur social. On a l’impression d’être revenu au Haut Moyen-âge lorsque l’on parcourt les installations sanglantes ou les conceptualisations sordides qui s’étalent dans les Foires dites d’Art contemporain. La joie et le sourire sont bannis de ces sabbats sinistres et prétentieux. Ils vous sont rendus lorsque vous parcourez les salles bien disposées et bien éclairées d’un musée où voisinent Titien et Véronèse, Boucher et Watteau, Corot et Matisse.
Marc Fumaroli
Thursday, September 20, 2012
Friday, September 14, 2012
Le récit à l’ère des réseaux
La finalité anthropologique du récit serait de « donner une épaisseur signifiante au passage du temps » dans une sphère culturelle d’expérience de la signification. Mais qu’en est-il du récit, de ses fonctions anthropologiques et littéraires avec l’entrée dans l’ère des réseaux ? [...] L’usage généralisé des nouveaux moyens de communication (ou médiums) que sont les réseaux télévisuels et de l’internet entraîne en effet de profonds changements culturels. Alors que le cinéma tend à faire usage des mêmes moyens narratifs que ceux de la création littéraire, les réseaux télévisuels et internet généralisent l’usage de la forme narrative, par exemple dans le reportage télévisé, dans le storytelling managérial générateur de récit d’entreprise, mais également dans les jeux vidéo. Les nouveaux contenus (ou médias), intimement liés à une logique marchande, engendrent, selon Jean-François Lyotard, une « détemporalisation » et une délocalisation » de l’information qui tendent à couper les liens ethnoculturels permettant jusqu’alors aux peuples de solliciter leur mémoire afin d’organiser l’espace et le temps. L’interactivité permet au récepteur de participer à la création en intervenant, dans une certaine limite, sur les contenus. La relation classique entre créateur individuel et récepteur passif s’en voit ainsi modifiée.
Françoise Dufour, Sylvie André, Le récit. Perspectives anthropologique et littéraire
Françoise Dufour, Sylvie André, Le récit. Perspectives anthropologique et littéraire
Monday, September 10, 2012
La lecture est une invention culturelle
La lecture est une invention culturelle qui n'était pas programmée pour voir le jour au regard de notre patrimoine génétique. Celui-ci prévoit l'utilisation de nos cinq sens, ainsi que de notre mémoire et de notre développement conceptuel. Le langage est également devenu un élément constitutif de notre espèce. Chomsky était tout à fait dans le vrai en affirmant dans Structures syntaxiques, sa thèse publiée en 1957, que l'espèce humaine a connu une évolution au cours de laquelle est apparu un programme génétique pour le langage oral. Mais rien de tel pour la lecture ! Nous ne disposons pas du moindre gène spécifique à celle-ci. Il s'agit là d'une différence énorme. La lecture n'est pas naturelle. Le cerveau humain ne donne pas le sentiment d'avoir été conçu par un ingénieur, car jamais un ingénieur n'aurait imaginé quelque chose qui puisse aller au-delà des parties qui le constituent. Or, quand un enfant s'adonne à la lecture, il façonne un nouveau circuit neuronal à partir de parties plus anciennes de son cerveau et génétiquement programmées pour autre chose : la vue, l'ouïe, le langage, la mémoire, etc. Ce sont les principes de connectivité et de plasticité (les deux vont de pair) qui permettent de comprendre le mécanisme de la lecture. La lecture renvoie à la capacité de créer quelque chose de nouveau à partir de ce qui existe déjà. Sa nouveauté tient précisément à cette réorganisation. La preuve même de la plasticité neuronale, c'est qu'un cerveau qui déchiffre le système d'écriture chinois fonctionne d'une manière très singulière et différente de la nôtre.
Maryanne Wolf
Sunday, September 9, 2012
Tuesday, September 4, 2012
Une grande famille
Les langues indo-européennes forment une très grande famille, regroupant aujourd’hui plus de 400 langages parlés par 3 milliards de personnes. Voici les principaux sous-groupes :
— les langues latines: français, espagnol, roumain, italien, catalan..
— les langues germaniques : anglais, allemand, danois, norvégien, suédois, flamand..
— les langues slaves : russe, serbo-croate, slovaque, tchèque…
— le grec
— les langues indo-iraniennes : hindi-ourdou, bengali, singhalais, panjabi, sanscrit (ancienne langue), persan..
— les langues celtiques : breton, gallois, irlandais…
— les langues baltes
Plusieurs langues parlées en Europe sont des exceptions notables et n’appartiennent pas à cette famille : le basque, le hongrois, le finnois, le lapon et l’estonien.
— les langues latines: français, espagnol, roumain, italien, catalan..
— les langues germaniques : anglais, allemand, danois, norvégien, suédois, flamand..
— les langues slaves : russe, serbo-croate, slovaque, tchèque…
— le grec
— les langues indo-iraniennes : hindi-ourdou, bengali, singhalais, panjabi, sanscrit (ancienne langue), persan..
— les langues celtiques : breton, gallois, irlandais…
— les langues baltes
Plusieurs langues parlées en Europe sont des exceptions notables et n’appartiennent pas à cette famille : le basque, le hongrois, le finnois, le lapon et l’estonien.
Thursday, August 30, 2012
La crise
… la crise, non pas du discours du maître, mais du discours capitaliste, qui en est le substitut, est ouverte.
C’est pas du tout que je vous dise que le discours capitaliste ce soit moche, c’est au contraire quelque chose de follement astucieux, hein ?
De follement astucieux, mais voué à la crevaison.
Enfin, c’est après tout ce qu’on a fait de plus astucieux comme discours. Ça n’en est pas moins voué à la crevaison. C’est que c’est intenable. C’est intenable… dans un truc que je pourrais vous expliquer… parce que, le discours capitaliste est là, vous le voyez… une toute petite inversion simplement entre le S1 et le S… qui est le sujet… ça suffit à ce que ça marche comme sur des roulettes, ça ne peut pas marcher mieux, mais justement ça marche trop vite, ça se consomme, ça se consomme si bien que ça se consume.
C’est pas du tout que je vous dise que le discours capitaliste ce soit moche, c’est au contraire quelque chose de follement astucieux, hein ?
De follement astucieux, mais voué à la crevaison.
Enfin, c’est après tout ce qu’on a fait de plus astucieux comme discours. Ça n’en est pas moins voué à la crevaison. C’est que c’est intenable. C’est intenable… dans un truc que je pourrais vous expliquer… parce que, le discours capitaliste est là, vous le voyez… une toute petite inversion simplement entre le S1 et le S… qui est le sujet… ça suffit à ce que ça marche comme sur des roulettes, ça ne peut pas marcher mieux, mais justement ça marche trop vite, ça se consomme, ça se consomme si bien que ça se consume.
Jacques Lacan (Milan, 12 mai 1972)
Wednesday, August 29, 2012
L'exemple
L’antinomie de l’individuel et de l’universel tire son origine du langage. Le mot arbre désigne en effet indifféremment tous les arbres, en tant qu’il suppose sa propre signification universelle au lieu des arbres singuliers ineffables (terminus supponit signifcatum pro re). Il transforme, autrement dit, les singularités en membres d’une classe, dont le sens définit la propriété commune (la condition d’appartenance). La fortune de la théorie des ensembles dans la logique moderne est due au fait que la définition de l’ensemble est simplement la définition de la signification linguistique. La Zusammenfassung en un tout M des objets singuliers distincts m, n’est autre que le nom. D’où les paradoxes inextricables des classes, qu’aucune « inepte théorie des types » ne peut prétendre résoudre. Les paradoxes définissent, en effet, le lieu de l’être linguistique. Celui-ci est une classe qui appartient et, en même temps, n’appartient pas à elle-même, et la classe de toutes les classes qui ne s’appartiennent pas à elles-mêmes est la langue. Puisque l’être linguistique (l’être-dit) est un ensemble (l’arbre) qui est, en même temps, une singularité (l’arbre, un arbre, cet arbre) et la médiation du sens, exprimée par le symbole e ne peut en aucune manière combler le hiatus où seul l’article réussit à se déplacer avec désinvolture.
Un concept qui échappe à l’antinomie de l’universel et du particulier nous est depuis toujours familier : c’est l’exemple. Quel que soit le contexte où il fait valoir sa force, ce qui caractérise l’exemple c’est qu’il vaut pour tous les cas du même genre et, en même temps, il est inclus en eux. Il constitue une singularité parmi d’autres, pouvant cependant se substituer à chacun d’elles, il vaut pour toutes. D’où la prégnance du terme qui, en grec, exprime l’exemple : para-deigma, ce qui se montre à côté (comme l’allemand Bei-spiel, ce qui joue à côté). Car le lieu propre de l’exemple est toujours à côté de soi-même, dans l’espace vide où se déroule sa vie inqualifiable et inoubliable. Cette vie est la vie purement linguistique. Inqualifiable et inoubliable est uniquement la vie dans la parole. L’être exemplaire est l’être purement linguistique. Exemplaire est ce qui n’est défini par aucune propriété, sauf l’être-dit. Non pas l’être-rouge, mais l’être-dit-rouge ; non l’être Jakob, mais l’être-dit Jakob définit l’exemple. D’où son ambiguïté, dès que l’on décide de le prendre vraiment au sérieux. L’être-dit - la propriété qui fonde toutes les appartenances possibles (l’être-dit italien, chien, communiste) ε est, en effet, également ce qui peut les remettre toutes radicalement en question. Il est le Plus Commun, qui scinde toute communauté réelle. D’où l’impuissante omnivalence de l’être quelconque. Il ne s’agit ni d’apathie ni de promiscuité ou de résignation. Ces singularités pures ne communiquent que dans l’espace vide de l’exemple, sans être rattachées à aucune propriété commune, à aucune identité. Elles se sont expropriées de toute identité, pour s’approprier de l’appartenance même, du signe ε. Tricksters ou fainéants, aides ou toons, ils sont le modèle de la communauté qui s’annonce.
Giorgio Agamben, La communauté qui vient
Uncertainty as a way of life
La réflexivité des représentations de l'étranger et du citadin appartient déjà au discours du flâneur, de l'arpenteur, de l'homme de la rue. La rue est la première image de la ville et elle est colorée, bigarrée. Confusion des langues : la ville est un monde, immense par évocation.
Tous les sens, ou presque, participent à l'impression cosmopolite : la vue et l'ouïe, le goût, l'odorat, à l'exclusion du toucher. C'est la prescription du toucher qui est décisive pour l'anthropologie urbaine des rencontres. Les corps se livrent à une danse étrange, tour à tour déployés chacun dans sa réserve de sens, dans son territoire, puis, happés au centre dans un grouillement infernal, ils sont contraints à la coprésence, au tact et à l'attention. La mise en scène de la vie quotidienne est un guide pour l'attention et le tact est décidément le contraire du toucher. Les territoires et les réserves sont des régions de sens normal, d'« apparences normales », dit Goffman. Au contraire les centres sont un melting-pot. Parfois à bon compte, et c'est du spectacle ; souvent tragiques et c'est l'ordinaire des relations inter-ethniques. Celles-ci sont le paradigme des « situations d'alarme » et nourrissent quotidiennement le discours de la scène urbaine, l'insécurité. L'insécurité urbaine s'évalue à vue d'œil et elle est réciproque. Personne n'est tranquille et tout le monde a peur.
Tout le monde se sent minoritaire : les minorités et les majorités, les envahisseurs et les envahis. Simplement, la peur du migrant n'est jamais une surprise et, la mémoire transie, coupé de sa réserve de sens, sans souvenir de la rue d'avant, il est inquiet à chaque instant. Uncertainty as a way of life.
Isaac Joseph, Urbanité et ethnicité
Tous les sens, ou presque, participent à l'impression cosmopolite : la vue et l'ouïe, le goût, l'odorat, à l'exclusion du toucher. C'est la prescription du toucher qui est décisive pour l'anthropologie urbaine des rencontres. Les corps se livrent à une danse étrange, tour à tour déployés chacun dans sa réserve de sens, dans son territoire, puis, happés au centre dans un grouillement infernal, ils sont contraints à la coprésence, au tact et à l'attention. La mise en scène de la vie quotidienne est un guide pour l'attention et le tact est décidément le contraire du toucher. Les territoires et les réserves sont des régions de sens normal, d'« apparences normales », dit Goffman. Au contraire les centres sont un melting-pot. Parfois à bon compte, et c'est du spectacle ; souvent tragiques et c'est l'ordinaire des relations inter-ethniques. Celles-ci sont le paradigme des « situations d'alarme » et nourrissent quotidiennement le discours de la scène urbaine, l'insécurité. L'insécurité urbaine s'évalue à vue d'œil et elle est réciproque. Personne n'est tranquille et tout le monde a peur.
Tout le monde se sent minoritaire : les minorités et les majorités, les envahisseurs et les envahis. Simplement, la peur du migrant n'est jamais une surprise et, la mémoire transie, coupé de sa réserve de sens, sans souvenir de la rue d'avant, il est inquiet à chaque instant. Uncertainty as a way of life.
Isaac Joseph, Urbanité et ethnicité
Monday, August 27, 2012
On parle de la magie de l'art
L'art est le seul domaine où la toute-puissance des idées se soit maintenue jusqu'à nos jours. Dans l'art seulement il arrive encore qu'un homme, tourmenté par des désirs, fasse quelque chose qui ressemble à une satisfaction ; et, grâce à l'illusion artistique, ce jeu produit les mêmes effets affectifs que s'il s'agissait de quelque chose de réel. C'est avec raison qu'on parle de la magie de l'art et qu'on compare l'artiste à un magicien. Mais cette comparaison est peut-être encore plus significative qu'elle le paraît. L'art, qui n'a certainement pas débuté en tant que « l'art pour l'art », se trouvait au début au service de tendances qui sont aujourd'hui éteintes pour la plupart. Il est permis de supposer que parmi ces tendances se trouvaient bon nombre d'intentions magiques.
Sigmund Freud, Totem et Tabou
Sigmund Freud, Totem et Tabou
On appellera utopie
Peut-être sommes-nous, à cet égard, dans une situation paradoxale : nous savons que, dans la réalité des faits, nous construisons l’avenir, en d’autres termes, que nous le voulions ou pas, nous savons que les choix qui se font aujourd’hui, choix proprement humains, auront des conséquences durables sur le monde que recevront les générations à venir. Alors, sauf à admettre que ces choix soient aveugles et que le destin du monde que nous fabriquons obéisse à des lois qui nous échappent définitivement, nous sommes contraints à l’utopie, un peu comme Sartre qui disait que nous sommes condamnés à être libres. On appellera utopie la distance qu’une société est capable de prendre avec elle-même, pour feindre ce qu’elle pourrait devenir.
Roland Schaer, L’espace, le temps, l’histoire, Utopie… la quête de la société idéale en Occident
L’art obéit aux même lois que toute autre activité libre de l’esprit
Pour Rumohr, l’œuvre d’art n’est pas seulement la matérialisation ou la métaphore d’une idée : elle fait partie en tant que telle du tissu des activités sociales, elle réagit et participe à la vie de la communauté : « L’art obéit aux même lois que toute autre activité libre de l’esprit ; les mêmes règles sous-tendent son jugement. Donc, les mêmes considérations doivent guider notre évaluation du mérite ou de l’absence de mérite des œuvre d’art […] que notre estimation de la qualité ou de l’absence de qualité des autres production humaines. En art, comme dans la vie en général, l’énergie, l’intensité, la portée, la bonté et la douceur, la précision et la clarté du but que l’on se donne prétendent à juste titre à notre approbation. » Rumohr observe par exemple que Giotto fut un innovateur en ce qui concerne la vitalité de ses images, et que c’est pour cette raison qu’il s’éloigna des idées de la tradition chrétienne. Il en vient à s’intéresser à ce qui fonde l’originalité des œuvres d’art en s’appuyant sur la personnalité de l’artiste. Ses méthodes d’historien lui font privilégier aussi les facteurs économiques et sociaux : pratiques commerciales, modes d’attribution des commandes publiques, relation des artistes avec la commanditaires, procédés techniques. Il est à l’origine des méthodes de la recherche moderne en histoire de l’art. Pour Hegel, l’art est un produit de la pensée discursive, pour Rumohr et son école, il est bien davantage le résultat des comportements sociaux.
Jean-Luc Chalumeau, Les théories de l’art
Friday, August 24, 2012
Des cartes postales illustrées
Dans les années 1900, envoyer et collectionner des cartes postales illustrées était une manie courante et souvent mortellement ennuyeuse à laquelle s’adonnaient des milliers de foyers bourgeois. Pourtant, la pléthore de cartes imprimées à cette époque forme de nos jours un solide point d’ancrage à partir duquel retracer les souvenirs les plus charmants et, parfois, les plus épouvantables jamais transmis d’une génération à l’autre. À leur apogée, la pureté de ces modestes vieilles cartes américaines resplendit des couleurs les plus vives en 1948. Car aujourd’hui les cartes connaissent un déclin esthétique dont elles ne se relèveront probablement jamais. Quintessence de l’inutile, la plupart des cartes récentes servent généralement de faire-valoir criard rapportant que telle et telle personne a visité tel et tel endroit et pour une raison quelconque y a passé un bon moment. Fini l’attachement à la vraie rue, à l’architecture de tous les jours ou à la présence humaine. À l’aube de ce siècle, la photographie en couleurs en était évidemment à ses balbutiements.
Walker Evans
Thursday, August 23, 2012
Wednesday, August 22, 2012
Réalisme
« Je ne me défie pas de la réalité, dont à vrai dire je ne sais trop rien, mais de l’image que nos sens nous délivrent de la réalité… » Gerhard Richter
Je ne tenais pas à me rapprocher de la réalité. Il me suffisait de garder le contact avec elle. Le maintenir était pourtant impossible.
Pour connaître ce qui se passe dans le monde, il ne reste que les journaux ainsi que leurs images. Rien qui soit vérifiable à partir de nos propres sens, si ce n’est justement ce reflet-là. Mais en l’absence d’informations de cette sorte, à quelle aune mesurer ce que les sens saisissent à leur proximité ? Une telle proximité, à sa manière, est irréelle. Je pourrais à tout instant me trouver ailleurs. Serais-je alors ici, en réel ? Me revoilà siégeant en pleine négociation, et de m’observer signifiant mon impatience d’un geste que je connaissais de ma mère. Cela m’a échappé. Des tours pareils (tout comme des tournures verbales que l’on a en tête) forment un chœur en concert avec diverses réalités issues du passé. Je les trimballe à travers mon quotidien, plus ou moins à mon insu. En définitive, ces blocs erratiques sur lesquels je trébuche font comprendre pourquoi, aux premières heures de ce lundi matin, je circule à vive allure dans les rues de Francfort. Ce lien avec les ancêtres rend improbable qu’un jour les connexions avec la réalité se perdent complètement, quand bien même on m’enfermerait durablement dans une cellule de quartier haute sécurité.
Je ne tenais pas à me rapprocher de la réalité. Il me suffisait de garder le contact avec elle. Le maintenir était pourtant impossible.
Pour connaître ce qui se passe dans le monde, il ne reste que les journaux ainsi que leurs images. Rien qui soit vérifiable à partir de nos propres sens, si ce n’est justement ce reflet-là. Mais en l’absence d’informations de cette sorte, à quelle aune mesurer ce que les sens saisissent à leur proximité ? Une telle proximité, à sa manière, est irréelle. Je pourrais à tout instant me trouver ailleurs. Serais-je alors ici, en réel ? Me revoilà siégeant en pleine négociation, et de m’observer signifiant mon impatience d’un geste que je connaissais de ma mère. Cela m’a échappé. Des tours pareils (tout comme des tournures verbales que l’on a en tête) forment un chœur en concert avec diverses réalités issues du passé. Je les trimballe à travers mon quotidien, plus ou moins à mon insu. En définitive, ces blocs erratiques sur lesquels je trébuche font comprendre pourquoi, aux premières heures de ce lundi matin, je circule à vive allure dans les rues de Francfort. Ce lien avec les ancêtres rend improbable qu’un jour les connexions avec la réalité se perdent complètement, quand bien même on m’enfermerait durablement dans une cellule de quartier haute sécurité.
Alexander Kluge pour Gerhard Richter
Saturday, August 18, 2012
Thursday, August 9, 2012
Le tyran
Du tyran, en effet, on ne se fera pas une image d’emblée sanglante. Le tyran est, en Grèce, d’abord un homme parvenu à la royauté par des moyens autres que la succession dynastique, mais pas nécessairement répréhensible. Il peut avoir été appelé pour dénouer une crise. Certes, il ne doit rien à personne, exerce son autorité sans autres limites que celles qu’il veut bien s’imposer. Il n’en veille pas moins à ne point violer les lois de la cité dont il a pris la tête. A cet égard, l’exercice du pouvoir par un homme seul n’a rien de choquant pour les Grecs. Il existe même une tyrannie "sacrée" : celle que les dieux exercent sur les hommes pour le bien de ces derniers. Les tyrans archaïques ne sont pas tous haïs par leurs sujets, ni chassés de leur trône par une insurrection. D’ailleurs deux tyrans célèbres, Pittacos de Mytilène et Périandre de Corinthe figurent parmi les Sept Sages de la Grèce. Un ouvrage donne ainsi des conseils au tyran : Hiéron ou de l’art d’être tyran (Xénophon) : maintenir l’affection populaire, avoir des mercenaires pour défendre la cité, et rendre ses sujets heureux.
Sur un ton semblable, Platon ne condamne pas la tyrannie. Elle n’est pas le gouvernement des meilleurs, mais elle permet plus sûrement que la démocratie aux meilleurs de s’approcher du pouvoir. On peut évidemment rappeler que Marc-Aurèle se souviendra de tout cela, d’autant qu’il va donner lui-même des conseils de "sagesse" aux romains.
Sur un ton semblable, Platon ne condamne pas la tyrannie. Elle n’est pas le gouvernement des meilleurs, mais elle permet plus sûrement que la démocratie aux meilleurs de s’approcher du pouvoir. On peut évidemment rappeler que Marc-Aurèle se souviendra de tout cela, d’autant qu’il va donner lui-même des conseils de "sagesse" aux romains.
Monday, August 6, 2012
Norme
Ruwen Ogien rappelle que le terme de « norme » a été employé et pensé habituellement selon trois sens :
— impératif ou prescriptif : la norme, c’est ce qu’il faut faire ou ne pas faire, ce qui est permis, obligatoire ou interdit.
— appréciatif : la norme, c’est ce qu’il est bien ou correct, mal ou incorrect d’être, de faire, de penser, de ressentir ou d’avoir fait, pensé, ressenti.
— descriptif : les normes sont les manières d’être, d’agir, de penser, de sentir les plus fréquentes ou les plus répandues dans une population donnée.
Ruwen Ogien, ‘Normes et valeurs’, M. Canto (dir.), Dictionnaire d’éthique et de philosophie morale, Paris, PUF, 1995, p. 1054.
Saturday, July 28, 2012
De fréquentes disputes
Mon compagnon et moi avons de vives et fréquentes disputes à propos de l'argent. Son salaire est beaucoup plus élevé que le mien et pourtant, comme j'aime embellir la maison, je dépense plus que lui qui n'achètera que par nécessité. Il me reproche beaucoup, par exemple, l'achat de robes car au fond il souhaite que je garde mon argent pour notre couple alors que lui-même dépense beaucoup pour ses enfants nés d'un premier mariage. Je me sens flouée mais je refoule mon ressentiment tandis que mon compagnon peut faire des colères terribles s'il se croit lésé. Souvent, je cache mes achats, alors que c'est avec mon propre argent, l'argent de mon travail, que je me les suis payées. Bref, c'est un peu l'enfer et mes plaisirs de consommation sont entachés de culpabilité.
Nathalie A.
Friday, July 27, 2012
Cassé
Christine. — Quand j’ai reçu ma lettre de licenciement, je me suis dit que dans un sens, c’était pas plus mal. Je commençais à en avoir marre de l’électroménager avec l’ambiance chez Prodex qui devenait pénible et que c’était tant mieux pour les Hongrois s’ils devenaient Prodex et se mettaient à assembler à leur tour. Je te jure, quand j’ai reçu ma lettre, j’ai ressenti du soulagement.
Cathy. — Tu m’as déjà raconté la lettre.
Christine. — Après dix-huit ans d’assemblage, je pensais retrouver du travail sans difficulté. Prodex, c’est quand même pas n’importe quoi, ça dit quelque chose à tout le monde. Enfin surtout aux vieux restés fidèles à la marque depuis les années soixante parce que c’était made in France et que les appareils avaient la réputation de jamais tomber en panne, un peu comme les appareils allemands qui avaient la réputation d’être solides à l’époque. Aujourd’hui, les jeunes s’en foutent que ce soit made in France. Made in Hongrie aussi, ils s’en foutent. Ce qu’ils veulent, c’est des appareils avec des couleurs flashy et des formes tarabiscotées, c’est ça qu’ils veulent. Et que ce soit solide, ils ne voient pas non plus l’intérêt. C’est juste que ça fait vieux, l’argument de la solidité, quand on est jeune.
Cathy. — La solidité aussi, tu m’as déjà raconté.
Christine. — C’est bon pour les vieux d’avoir un appareil qui dure longtemps. Une Prodex. Une vieille Prodex qu’on branche et qui démarre au quart de tour. Dis donc, maman, tu l’as depuis combien de temps, ta cocotte ? Tu voudrais pas qu’on t’en achète une nouvelle pour ton anniversaire ? Pour tes 60 ans, tu voudrais pas d’une cocotte neuve ? Laisse, ma fille, j’en ai pas besoin d’une nouvelle, celle-là durera encore assez longtemps et tu sais pourquoi ? C’est une Prodex !
Cathy. — Voilà !
Christine. — Ça, c’est le côté renfermé des vieux que les jeunes supportent pas. Ils préfèrent acheter des appareils tous les deux ans pourvu qu’ils soient de couleur flashy, et comme ça coûte moins cher vu que c’est de moins bonne qualité tout le monde est content, surtout les Chinois puisque c’est leur marque de fabrique, les appareils de mauvaise qualité à des prix défiant toute concurrence. Mais maintenant que l’assemblage va se passer en Hongrie, ce sera sans doute moins cher et ils vont peut-être en profiter pour revoir la gamme des couleurs et des formes aussi, par la même occasion.
Cathy. — Tu voudrais pas changer de disque ?
Rémy De Vos
Working
Je reste sur place, sur une surface d’un mètre, un mètre cinquante toute la nuit. Le seul moment où on s’arrête, c’est quand la chaîne s’arrête. On fait à peu près trente-deux opérations par pièce, par voiture, quoi. Quarante-huit pièces à l’heure, huit heures par jour. Trente-deux fois quarante-huit fois huit. Calculez. C’est le nombre de fois que je pousse le bouton. Le bruit, c’est terrible. Si vous ouvrez la bouche vous risquez de prendre plein d’étincelles dedans. (Il montre ses bras.) Ça, c’est une brûlure, tout ça, c’est des brûlures. On peut pas lutter avec le bruit. Vous gueulez et en même temps vous poussez pour amener le poste de soudure à l’endroit qu’il faut.
Les types sont pas sociables, renfermés. C’est trop dur. On s’occupe de soi. On rêve, on pense à des choses qu’on a fait. Je reviens tout le temps à quand j’étais gosse et puis ce qu’on faisait, les frangins et moi. Les choses qu’on aime, c’est à ça qu’on revient toujours.
Des tas de fois, j’ai bossé depuis le moment que je commençais jusqu’à la pause, sans me rendre compte que je bossais. Quand vous rêvez, vous diminuez les risques d’accrochage avec le contremaître ou avec le voisin.
Ça s’arrête pas. Ça continue toujours et toujours et toujours. Je parie qu’il y a des hommes qui ont passé leur vie ici et qui ont jamais vu le bout de la chaîne. Et ils le verront jamais — il y en a pas. C’est comme un serpent. Rien que le corps, pas de queue. Ça peut vous faire des trucs... (Il rit.)
C’est tellement monotone que si on pensait vraiment au boulot, à la répétition, on deviendrait dingue, tout doucement. Si vous pensez à vos problèmes, ils s’accumulent et vous pourriez sauter à la gorge du type qui est à côté de vous. Chaque fois que le contremaître passe, vous auriez quelque chose à dire. Vous tapez sur n’importe quoi, ce que vous avez sous la main. Comme ça, vous vous occupez de vous, rien que de vous tout seul, vous évitez les ennuis.
Phil Stallings, soudeur à l’arc, décrit le travail à la chaîne chez Ford Chicago au début des années 1970
Wednesday, July 25, 2012
Le "Leonard de Vinci" des drogues
Alexander Shulgin est onsidéré comme le "Leonard de Vinci" des drogues par ses fans, ce dernier serait à l’origine de la diffusion de deux cent drogues synthétiques, dont la MDMA, molécule de l’ecstasy. Le succès commercial de l’insecticide Zectran, qu’il mit au point dans les années 1950, lui permit d’entreprendre librement des recherches sur les drogues psychédéliques, chez le géant américain Dow Chemical puis pour la DEA, les stups américains. "C’est donc avec la bénédiction du gouvernement fédéral américain qu’Alexander Shulgin allait inventer la pharmacopée psychédélique moderne." Nombre des drogues qu’il découvrit ou redécouvrit, comme la mescaline ou le LSD, servaient d’objets de recherche en psychothérapie avant de trouver leurs adeptes dans un cadre récréatif. Finalement lâchés par une DEA méfiante devant l’influence potentielle de leurs inventions, Shulgin et sa femme Ann, militants convaincus de la légalisation de toutes les drogues, consignèrent la plupart de leurs découvertes dans deux livres inclassables, PiHKAL, une histoire d’amour chimique et TiHKAL (Tryptamines I have Known and Loved. La DMT et la psilocybine des chamignons sont des tryptamines), parus en 1991 et 1997. On leur attribue l’extension à l’échelle mondiale des designer drugs, fabriqués à partir des formules présentées dans ces deux ouvrages. "Normalement, quand j’invente une molécule et qu’elle devient populaire, ils attendent environ quatre ans pour l’interdire", disait Alexander Shulgin au magazine Vice. Agé de 87 ans, il aurait mis fin à ses expériences !
Souriez, vous êtes drogués
Souriez, vous êtes drogués
Tuesday, July 17, 2012
Les livres en danger
Je n’ai aucune envie de parler de la littérature, de son importance, de ses valeurs. Ce que j’ai à l’esprit en ce moment, c’est une chose plus concrète : la bibliothèque. Ce mot donne, au prix que vous avez la bonté de m’accorder une étrange note nostalgique ; car il me semble que le temps qui, impitoyablement, poursuit sa marche, commence à mettre les livres en danger. C’est à cause de cette angoisse que, depuis plusieurs années déjà, j’ajoute à tous mes contrats, partout, une clause stipulant que mes romans ne peuvent être publiés que sous la forme traditionnelle du livre. Pour qu’on les lise uniquement sur papier, non sur un écran. Cela me fait penser à Heidegger, au fait apparemment paradoxal que, lors des pires années du XXème siècle, il se concentrait dans ses cours universitaires sur la question de la technique, pour constater que la technique, son évolution accélérée, est capable de changer l’essence même de la vie humaine.
Voici une image qui, de nos jours, est tout à fait banale : des gens marchent dans la rue, ils ne voient plus leur vis à vis, ils ne voient même plus les maisons autour d’eux, des fils leur pendent de l’oreille, ils gesticulent, ils crient, ils ne regardent personne et personne ne les regarde. Et je me demande : liront-ils encore des livres ? c’est possible, mais pour combien de temps encore ? Je n’en sais rien. Nous n’avons pas la capacité de connaître l’avenir. Sur l’avenir, on se trompe toujours, je le sais. Mais cela ne me débarrasse pas de l’angoisse, l’angoisse pour le livre tel que je le connais depuis mon enfance. Je veux que mes romans lui restent fidèles. Fidèles à la bibliothèque.
Milan Kundera, lors de la remise du prix de la BnF 2012 pour l’ensemble de son oeuvre
Wednesday, July 11, 2012
Wednesday, July 4, 2012
Sérieux du pèlerinage et frivolité du tourisme
Un visiteur assistant au Sri Lanka à des manifestations religieuses - le pèlerinage à Kataragama dans notre exemple - pourrait penser que la foi et la piété tendent à décliner dans ce pays. Dans ce lieu de dévotion, on est surpris par l'allure désinvolte de jeunes bouddhistes qui peut choquer les visiteurs non avertis (c'est aussi un sanctuaire saint pour les hindouistes). La fête et une certaine "débauche" sont présentes ; la sympathie manifestée envers le sexe opposé s'exprime franchement et des danses très suggestives sont effectuées sous l'oeil du badaud. Le Walkman rivalise avec les dernières trouvailles vestimentaires occidentales. On pourrait, a priori, qualifier ce phénomène de dégénérescence d'une pratique traditionnelle, qui se serait transmuée en recherche de plaisir et en divertissement sous des prétextes religieux. Au demeurant, cette situation caractérise aussi, à des degrés divers, d'autres pèlerinages tels que celui de Lourdes. (La Réforme a longtemps dénoncé ces pratiques dans lesquelles elle voyait des reliquats de paganisme.).
Les journalistes sri lankais dénoncent eux aussi ces comportements qu'ils considèrent comme une dégradation et une déliquescence manifestes de la foi. Ils s'offusquent, reprenant à leur compte la connotation de frivolité évoquée par le terme de tourisme, et attribuent cette "déviance" au développement effréné du tourisme de masse dans leur pays. [...]
Cependant, en changeant d'angle d'approche, on peut à juste titre inscrire ces faits dans une dynamique interne à la tradition du pèlerinage au Sri Lanka.
Ces comportements, répréhensibles à première vue, prennent une tout autre signification dès qu'on les appréhende selon une perspective historique. En effet, les traditions de pèlerinage montrent, entre autres faits, qu'au-delà des innovations comportementales observées (Walkman, jeans et apparence occidentale) les jeunes Sri Lankais de confession bouddhiste ont repris à leur compte un style de pèlerinage hindouiste assez ancien, qu'ils actualisent et s'approprient à leur façon. [...]
Le style de pèlerinage hindouiste, emprunté ainsi par les bouddhistes, est adressé à Murukan, dieu hindouiste, fils de Shiva, un dieu bien accommodant comme nous allons le voir. Ce dieu a la particularité de n'exiger de ses adeptes qu'une dévotion infaillible, les comportements profanes de ses adeptes, en termes de bien ou de mal, lui important peu. Il est perçu comme un père inconditionnellement aimant et prêt à tout pour ses enfants, quels que soient leurs mérites, pour peu qu'ils sentent en eux une foi sincère à son égard. Cette divinité assure de sa grâce toute personne, quels que soient sa caste, son sexe ou son origine, ou ses faits et méfaits, contredisant ainsi le système des castes hindouistes. Les jeunes Sri Lankais bouddhistes furent attirés par ce dieu aux qualités a-morales. Il est perçu comme violent, brutal, n'ayant aucun scrupule, rusé, et n'hésitant pas à se battre pour le bien dans ce monde impur de la modernité. Bref, il apparaît comme un allié sûr pour ces jeunes plongés dans l'incertitude de la vie moderne (chômage, absence de perspectives d'avenir, corruption et passe-droits divers - bref, le quotidien d'un pays du tiers-monde). Appelé Skanda par les bouddhistes ou Makaruna par les hindouistes, ce dieu incarne la modernité dans l'esprit des jeunes Sri Lankais, qui voient en lui un recours et une divinité fidèle qui les suit dans leurs pérégrinations au sein du monde actuel. Plus qu'un phénomène d'acculturation ou un rejet des traditions, que le tourisme provoquerait, ce pèlerinage donne l'exemple d'une continuité et d'une capacité d'intégration et de réinterprétation de la tradition en termes modernes [...].
Les journalistes sri lankais dénoncent eux aussi ces comportements qu'ils considèrent comme une dégradation et une déliquescence manifestes de la foi. Ils s'offusquent, reprenant à leur compte la connotation de frivolité évoquée par le terme de tourisme, et attribuent cette "déviance" au développement effréné du tourisme de masse dans leur pays. [...]
Cependant, en changeant d'angle d'approche, on peut à juste titre inscrire ces faits dans une dynamique interne à la tradition du pèlerinage au Sri Lanka.
Ces comportements, répréhensibles à première vue, prennent une tout autre signification dès qu'on les appréhende selon une perspective historique. En effet, les traditions de pèlerinage montrent, entre autres faits, qu'au-delà des innovations comportementales observées (Walkman, jeans et apparence occidentale) les jeunes Sri Lankais de confession bouddhiste ont repris à leur compte un style de pèlerinage hindouiste assez ancien, qu'ils actualisent et s'approprient à leur façon. [...]
Le style de pèlerinage hindouiste, emprunté ainsi par les bouddhistes, est adressé à Murukan, dieu hindouiste, fils de Shiva, un dieu bien accommodant comme nous allons le voir. Ce dieu a la particularité de n'exiger de ses adeptes qu'une dévotion infaillible, les comportements profanes de ses adeptes, en termes de bien ou de mal, lui important peu. Il est perçu comme un père inconditionnellement aimant et prêt à tout pour ses enfants, quels que soient leurs mérites, pour peu qu'ils sentent en eux une foi sincère à son égard. Cette divinité assure de sa grâce toute personne, quels que soient sa caste, son sexe ou son origine, ou ses faits et méfaits, contredisant ainsi le système des castes hindouistes. Les jeunes Sri Lankais bouddhistes furent attirés par ce dieu aux qualités a-morales. Il est perçu comme violent, brutal, n'ayant aucun scrupule, rusé, et n'hésitant pas à se battre pour le bien dans ce monde impur de la modernité. Bref, il apparaît comme un allié sûr pour ces jeunes plongés dans l'incertitude de la vie moderne (chômage, absence de perspectives d'avenir, corruption et passe-droits divers - bref, le quotidien d'un pays du tiers-monde). Appelé Skanda par les bouddhistes ou Makaruna par les hindouistes, ce dieu incarne la modernité dans l'esprit des jeunes Sri Lankais, qui voient en lui un recours et une divinité fidèle qui les suit dans leurs pérégrinations au sein du monde actuel. Plus qu'un phénomène d'acculturation ou un rejet des traditions, que le tourisme provoquerait, ce pèlerinage donne l'exemple d'une continuité et d'une capacité d'intégration et de réinterprétation de la tradition en termes modernes [...].
Rachid Amirou
Révolution psychique engagée par la culture numérique
Les technologies numériques modifient enfin le fonctionnement psychique de plusieurs façons.
1. Tout d’abord, l’identité se démultiplie. Le Moi n’est plus la propriété privée d’un individu, mais une construction à chaque fois tributaire des interactions. Le psychisme humain est un dispositif d’interaction intériorisé qui se complète et se nuance sans cesse sous l’effet de nouvelles communications. A chaque moment, il en est de nos identités comme des vêtements dans notre garde-robe. Nous les essayons à la recherche de notre personnalité décidément insaisissable. Les identités multiples et les identifications flottantes définissent une nouvelle normalité dont la plasticité est la valeur ajoutée, tandis que l’ancienne norme du « moi fort intégré » est disqualifiée en psychorigidité. Quant à la pathologie, elle ne commence que quand ses identités échappent au sujet et qu’il devient incapable de différencier le dedans du dehors, l’intériorité de l’extériorité.
2. Ensuite, avec les technologies numériques, le clivage s’impose comme mécanisme défensif prévalent sur le refoulement. Sur Internet, en effet, aucun contenu n’est réprimé et tous sont accessibles instantanément par l’ouverture d’une « fenêtre » : c’est le système « windows ». Or cette logique correspond exactement à ce qui se passe lorsque, dans le clivage, nous sommes capable de penser à une chose, et aussitôt après de l’oublier comme si elle n’avait jamais existé. Du coup, les contraires peuvent y coexister sans s’exclure. Cela renforce le processus du clivage aux dépends du refoulement, avec des effets considérables sur l’éducation.
3. Enfin, Internet reproduit la caractéristique de notre mémoire qui est d’être un espace d’invention permanente dans lequel rien n’est daté de telle façon que le passé peut toujours être confondu avec le présent. Alors que la culture du livre fait une grande place à la succession et à la narration (avec un avant, un pendant, un après et un conditionnel), celle des écrans se déroule dans un éternel présent.
Serge Tisseron
Friday, June 29, 2012
Tuesday, June 26, 2012
Fractal
Le terme fractal vient d'un néologisme inventé par Mandelbrot, du latin « fractus » qui signifie irrégulier ou brisé, et les objets qualifiés de fractals ont pour caractéristiques principales la dimension fractale : « L’œil ne permet plus de fixer de tangente en un point : une droite qu’on aurait porté à dire telle, au premier abord, paraîtra aussi bien, avec un peu plus d'attention, perpendiculaire ou oblique au contour. Si on prend une loupe, un microscope, l'incertitude reste aussi grande, car chaque fois qu'on augmente le grossissent, on voit apparaître des anfractuosités nouvelles, sans jamais éprouver l'impression nette et reposante que donne, par exemple, une bille d'acier poli ». La côte de Bretagne, le chou romanescu, le flocon, etc... seront des exemples d'objets fractals, très répandus dans la nature, que la courbe de Koch montre comme irréguliers, en variation infinie et dont la structure ne change pas malgré le changement d'échelle. Les objets fractals, composés d’itérations, ont une rugosité permettant une mesure non entière, car en effet, leurs propriétés particulières, l'auto-similarités, accepte que chaque partie ressemble à l'objet lui-même.
Monday, June 25, 2012
Le mur des fainéants
À Tanger — En marchant le long du boulevard Pasteur, Genet remarqua un groupe de jeunes gens, garçons et filles, assis sur un petit mur surnommé par les Tangérois “le mur des fainéants”. Il les regarda, s’arrêta, puis me dit : “Tu vois ces jeunes qui s’emmerdent là, si ton roi avait un minimum de respect pour son peuple, il affréterait des avions pour emmener ces jeunes gens voir l’exposition Van Gogh au Grand Palais à Paris. Oui, il les ferait accompagner de professeurs connaissant bien le sujet et je te garantis que ce voyage changerait la vie de ces lycées ou chômeurs. Oui, les emmener au musée, puis au théâtre et même à l’opéra. Tu trouves ça ridicule ? Pas moi. Ça ne viendrait jamais à l’idée du roi et pourtant ça lui coûterait à peine ce qu’il dépense en un matin quand il part jouer au golf !” Cette idée belle et saugrenue, sublime et extravagante, m’a obsédé longtemps. J’y repense de temps en temps. Un jour, j’ai failli en parler au roi Mohamed VI, mais ce fut impossible, les quelques fois où je l’ai vu le protocole intervenait vite et me faisait comprendre qu’il fallait partir. Je pense que l’idée de Genet est toujours valable. Peut-être qu’un ministre de la Culture la réalisera un jour.
Tahar Ben Jelloun, Jean Genet, Menteur Sublime
Sunday, June 24, 2012
Au Japon, on ne parle pas de soi
Au Japon, on ne parle pas de soi. Les deux mots clés structurant le rapport aux autres sont « Gambarimasu » (頑張る, persévérer, faire de son mieux) et « Gaman » (我慢, endurer, faire bonne figure). Le social inhibe l’intime dans le langage. Alors on y est seul. Le japonais, c’est l’expérience de la solitude, du silence : le Japonais est silentiaire.
Les erreurs les plus fréquentes chez les écrivains
Erreur sur le genre du texte : ce qui se veut un roman se transforme en témoignage, en cours d’histoire, en règlement de comptes ou en manifeste idéologique.
Erreur sur le narrateur : mauvais choix de narrateur (ce n’est pas la bonne personne qui raconte l’histoire) ou bien l’auteur se met à parler à la place de son narrateur (un peu comme si on voyait le réalisateur entrer dans le champ de la caméra).
Pauvreté des personnages : personnages vides, sans consistance.
Coquetteries de forme : problème typique du débutant. Pour ne pas faire comme tout le monde, les choix de style ou de structure sont dictés par des raisons extérieures au récit (pour faire joli, original, etc.).
Erreur sur le narrateur : mauvais choix de narrateur (ce n’est pas la bonne personne qui raconte l’histoire) ou bien l’auteur se met à parler à la place de son narrateur (un peu comme si on voyait le réalisateur entrer dans le champ de la caméra).
Pauvreté des personnages : personnages vides, sans consistance.
Coquetteries de forme : problème typique du débutant. Pour ne pas faire comme tout le monde, les choix de style ou de structure sont dictés par des raisons extérieures au récit (pour faire joli, original, etc.).
Laure Pécher, agent littéraire et formatrice en ateliers d’écriture
La parole à l’état de foudre
La presse est un élément jadis ignoré, une force autrefois inconnue, introduite maintenant dans le monde ; c’est la parole à l’état de foudre ; c’est l’électricité sociale. Pouvez-vous faire qu’elle n’existe pas ? Plus vous prétendrez la comprimer, plus l’explosion sera violente. Il faut donc vous résoudre à vivre avec elle, comme vous vivez avec la machine à vapeur. Il faut apprendre à vous en servir, en la dépouillant de son danger, soit qu’elle s’affaiblisse peu à peu par un usage commun et domestique, soit que vous assimiliez graduellement vos mœurs et vos lois aux principes qui régiront désormais l’humanité.
François-René de Chateaubriand, Mémoires d'outre-tombe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
L’instruction élémentaire des masses donne des consommateurs sans bornes à la parole imprimée, les chemins de fer lui ouvrent des routes, la vapeur lui prête des ailes, le télégraphe visuel lui donne des signes ; enfin l’invention récente du télégraphe électrique lui communique l’instantanéité de la foudre. Plus réellement que dans le vers célèbre de Franklin : Eripuit cœlo fulmen ! dans quelques années, un mot prononcé et reproduit sur un point quelconque du globe pourra illuminer ou foudroyer l’univers.
Alphonse de Lamartine, Gutenberg, 1853
Friday, June 22, 2012
Time is money
L’analogie du temps avec l’argent est par contre fondamentale pour analyser “notre temps”, et ce que peut impliquer la grande coupure significative entre temps de travail et temps libre, coupure décisive, puisque c’est sur elle que se fondent les options fondamentales de la société de consommation. Time is money : cette devise inscrite en lettres de feu sur les machines à écrire Remington l’est aussi au fronton des usines, dans le temps asservi de la quotidienneté, dans la notion de plus en plus importante de “budget-temps”. Elle régit même — et c’est ce qui nous intéresse ici — le loisir et le temps libre. C’est encore elle qui définit le temps vide et qui s’inscrit au cadran solaire des plages sur le fronton des clubs de vacances. Le temps est une denrée rare, précieuse, soumise aux lois de la valeur d’échange. Ceci est clair pour le temps de travail, puisqu’il est vendu et acheté. Mais de plus le temps libre lui-même doit être, pour être “consommé”, directement ou indirectement acheté. Norman Mailer analyse le calcul de production opéré sur le jus d’orange, livré congelé ou liquide (en carton). Ce dernier coûte plus cher parce qu’on inclut dans le prix les deux minutes gagnées sur la préparation du produit congelé : son propre temps libre est ainsi vendu au consommateur. Et c’est logique, puisque le temps “libre” est en fait du temps “gagné”, du capital rentabilisable, de la force productive virtuelle, qu’il faut donc racheter pour en disposer.
Jean Baudrillard, La Société de consommation
La publicité
La publicité constitue la dernière en date de ces tentatives. Bien qu’elle vise à susciter, à provoquer, à être le désir, ses méthodes sont au fond assez proches de celles qui caractérisaient l’ancienne morale. Elle met en effet en place un Surmoi terrifiant et dur, beaucoup plus impitoyable qu’aucun impératif ayant jamais existé, qui se colle à la peau de l’individu et lui répète sans cesse : “Tu dois désirer. Tu dois être désirable. Tu dois participer à la compétition, à la lutte, à la vie du monde. Si tu t’arrêtes, tu n’existes plus. Si tu restes en arrière, tu es mort.” Niant toute notion d’éternité, se définissant elle-même comme processus de renouvellement permanent, la publicité vise à vaporiser le sujet pour le transformer en fantôme obéissant du devenir. Et cette participation épidermique, superficielle à la vie du monde est supposée prendre la place du désir d’être. La publicité échoue, les dépressions se multiplient, le désarroi s’accentue ; la publicité continue cependant à bâtir les infrastructures de réception de ces messages. Elle continue à perfectionner des moyens de déplacement pour des êtres qui n’ont nulle part où aller, parce qu’ils ne sont nulle part chez eux ; à développer des moyens de communication pour des êtres qui n’ont plus rien à dire ; à faciliter les possibilités d’interaction entre des êtres qui n’ont plus envie d’entrer en relation avec quiconque.
Michel Houellebecq, Les Particules élémentaires
Un instrument d’interprétation du monde
La cartographie, terme né à la fin du XIXe siècle, renvoie aujourd’hui à toute une série de pratiques pluridisciplinaires. Selon Turnbull, cartographier signifie en général « assembler des savoirs locaux », savoirs qui sont de nature fondamentalement géographiques. Ainsi, cartographier les villes, les campagnes, les mers et les paysages, les lieux et les espaces contribuent à l’élaboration de géographies réelles et fictionnelles qui exercent une influence politique et économique, sociale et culturelle. Ainsi, relève Casti, la cartographie est aussi devenue « une théorie des actes cognitifs et des technologies par lesquels l’homme réduit la complexité environnementale et s’approprie intellectuellement le monde ». La cartographie est donc aussi un « instrument d’interprétation du monde », un langage, mobilisé tant pour essayer de rendre compte du réel (cartes documentaires des voyageurs, des géographes) que de l’imaginaire (cartes jointes à des romans, des bandes dessinées).
[...]
Bien souvent nourri par un imaginaire de lieux, l’écrit littéraire a partie liée avec la géographie. Daniels et Rycroft avancent l’hypothèse que la forme littéraire est géographique de façon inhérente car le monde du roman est fait d’emplacements et de milieux, de territoires et de frontières, de perspectives et d’horizons. Des espaces et des lieux sont investis et imaginés . Westphal quant à lui développe la géocritique, une méthode d’analyse qui mobilise « la théorie littéraire, la géographie culturelle et l'architecture » . Qu’elles s’ancrent plus ou moins fidèlement dans des lieux réels ou dépeignent des univers fictionnels, les narrations sont donc aussi des instruments de connaissance permettant, par le détour de l’imaginaire, d’appréhender le réel. En retour, si la démarche scientifique qui consiste à explorer les fictions pour en donner une lecture des sociétés est peu courante en France, comme l’a souligné Musset, quelques essais précurseurs avaient cependant ouvert la voie (Frémont cartographiant l’espace vécu de Madame Bovary , Lacoste redessinant le cadre géopolitique du Rivage des Syrtes , …) ; ces approches actuellement renouvelées par des expériences novatrices de cartographie et de modélisation des œuvres de fiction qui en démontrent tout l’intérêt au plan heuristique (par exemple Semmoud et Troin ou Brosseau ).
Sunday, June 10, 2012
Virtuel x 3
Notre culture contemporaine semble réaliser une brillante synthèse entre l'intégration la plus poussée, celle des fonctions, celle des espaces, celle des hommes, et l'éjection la plus radicale, le rejet quasi-biologique — le système nous expulsant à mesure qu'il nous intègre, dans d'innombrables prothèses techniques, jusqu'à la toute dernière et la plus admirable : celle de la pensée dans l'Intelligence Artificielle [..] Tout sera à la fois accompli, réalisé, et éjecté dans le vide. Nous entrerons, délivrés de nous-mêmes, dans l'univers spectral et sans problèmes. Ça, c'est la Grande Virtualité.
Jean Baudrillard, Le Crime parfait
L'assurance des défenseurs inconditionnels du virtuel provient de leur soumission face au miroitement des images et aux possibilités insondables dispensées par les différents réseaux. Ils s'assurent par là une publicité de convenance et une intervention éphémère sur les médias qui les satisfont au plus haut point. Le discours intellectualiste conformiste s'acoquine avec les médias les plus ordinaires, et c'est très bien ainsi.
Alain Gauthier, Le Virtuel au quotidien
Prôner la suppression de l'humanité comme réalisation de la liberté humaine — ce que font les prophètes hallucinés du cyborg, cet hybride homme-machine, ou encore ceux qui prétendent remodeler l'humanité en bidouillant son génome — c'est toujours, en fin de compte, vouloir réaliser le même rêve : remplacer l'individu humain tel que nous le connaissons, gênant et maladroit, avec son intolérable lot d'imperfections, par quelque chose de nouveau et de meilleur, ce qui serait en effet la confirmation, tant attendue, de l'idéologie du progrès. Mais toutes ces fuites en avant ne prouvent qu'une seule chose : le désarroi, voire le délabrement intellectuel de leurs partisans.
Jean-Marc Mandosio, Après l'effondrement
Jean Baudrillard, Le Crime parfait
L'assurance des défenseurs inconditionnels du virtuel provient de leur soumission face au miroitement des images et aux possibilités insondables dispensées par les différents réseaux. Ils s'assurent par là une publicité de convenance et une intervention éphémère sur les médias qui les satisfont au plus haut point. Le discours intellectualiste conformiste s'acoquine avec les médias les plus ordinaires, et c'est très bien ainsi.
Alain Gauthier, Le Virtuel au quotidien
Prôner la suppression de l'humanité comme réalisation de la liberté humaine — ce que font les prophètes hallucinés du cyborg, cet hybride homme-machine, ou encore ceux qui prétendent remodeler l'humanité en bidouillant son génome — c'est toujours, en fin de compte, vouloir réaliser le même rêve : remplacer l'individu humain tel que nous le connaissons, gênant et maladroit, avec son intolérable lot d'imperfections, par quelque chose de nouveau et de meilleur, ce qui serait en effet la confirmation, tant attendue, de l'idéologie du progrès. Mais toutes ces fuites en avant ne prouvent qu'une seule chose : le désarroi, voire le délabrement intellectuel de leurs partisans.
Jean-Marc Mandosio, Après l'effondrement
Choix dans le regard
William Klein, dans sa série de documentaires intitulée Contacts (réalisés pour le centre national de la photographie), demande à différents photographes d’expliquer leurs choix par rapport à une série de photos sur planche-contact, il pointe à juste titre l’importance de cette histoire-là, de cette genèse-là. La photo, comme l’image vidéo, est le fruit du rapport d’un individu avec une situation et de son choix, choix dans le regard, comme ensuite choix de présentation dans les circuits de diffusion. Rien n’est moins “naturel” et normal : que ce soit l’insistance sur l’à-côté de l’action, le détail, la micro-photo, ou le grand angle, la macro-photo, la conjonction chaotique, boulimique, d’éléments sans rapport et pourtant raccordés, que ce soit la diffusion sans apprêt d’un polaroïd ou la retouche, le redécoupage, l’imbrication savante avec un titre.
Laurent Gervereau, Rapporter le réel, Éthique esthétique politique, 1997
Friday, June 8, 2012
Thursday, June 7, 2012
C’est de l’art
Pour sa prolifique descendance, l’acte de l’art ne consiste plus dans
la fabrication d’un objet que l’on peut désigner comme œuvre, mais dans
un geste, parfois informe : celui de déplacer un objet, d’en changer
l’orientation ou d’en modifier le nom, et ainsi d’en transformer le
statut, ou celui de la collecte, de la récupération d’image déjà
existantes. Dans le cas d’Élevage de poussière (1920) de Duchamp et Man
Ray, la photographie, en lumière rasante, d’un amas de poussière déposé
sur le Grand Verre figure le geste minime de laisser faire,
laisser être, laisser le dépôt de poussière se produire, laisser voir la
marque du temps. L’abstention même est un geste. Aussi peut-on être
artiste même dans l’inaction. L’« être artiste » est un état permanent.
C’est une qualité inaliénable. Dès 1925, Kurt Schwitters le proclame :
« tout ce qu’un artiste crache, c’est de l’art », maxime à laquelle
Piero Manzoni donne en 1961 une acception élargie, d’un orifice à
l’autre. L’artiste en sa totalité est art. Art total, il ne l’est pas en
vertu de son œuvre, mais en vertu de son être. Aussi pense-t-il qu’il
lui suffit d’un geste de désignation, comme s’il se croyait le seigneur
signifiant à saint Matthieu sa vocation, pour métamorphoser une personne
quelconque en « sculpture vivante », ainsi que Manzoni le faisait en
1961, par apposition de sa signature sur des passants.
Jean Galard, L’art sans œuvre, in L’œuvre d’art totale
Wednesday, June 6, 2012
Friday, June 1, 2012
Le quartier
La ville peut-elle être appréhendée comme une « pâte urbaine » qui mêle les consciences et le tissu urbain : dès lors, si la médiation des lieux peut être « oubliée » par ses habitants, l’appartenance à un quartier en fait un opérateur central :
« Nous pouvons concevoir les relations des hommes à leur quartier de plusieurs façons. Ou bien ils traversaient l’opacité des lieux – médiation nécessaire mais oubliée […]. Ou bien ils nouaient leur existence commune à même la pâte urbaine. Ou encore, et cette fois la relation se fait indirecte, le décor les avait polis d’une certaine façon et les avaient rendus semblables par quelques côtés. » Pierre Sansot, Poétique de la ville, 1971
Wednesday, May 30, 2012
La photo-numérique est langagière
Alors que la matière de la photo-argentique, faite de sels d’argent et de papier, est chimique, la matière de la photo-numérique est langagière. Elle est faite de signes et de codes informatiques, d’algorithmes. Alors que dans un appareil de photo-argentique la lumière agit sur une surface chimiquement sensible, l’appareil de photo-numérique est, lui, muni de capteurs et de processeurs grâce auxquels l’action de la lumière est convertie en signes informatiques - en langage.
La photo-numérique rompt l’homogénéité de matière entre les choses et les images qui, dans la photo-argentique, était assurée par la lumière et les sels d’argent. Un contact physique a bien lieu entre les choses et le dispositif numérique de saisie, mais il ne s’accompagne plus d’un échange énergétique entre les choses et les images. La transformation ne s’opère plus de chose à chose, des choses du monde à des images-choses, mais de chose à image-langage.
On passe du monde chimique et énergétique des choses et de la lumière au monde logico-langagier des images numériques. L’ancienne continuité matérielle entre la chose et son image argentique est brisée au profit d’une conversion de la matière en langage - autrement dit, au profit d’une virtualisation. C’est donc dès l’étape de la saisie que s’opère la rupture du lien physique et énergétique, rupture qui fonde l’altérité essentielle par laquelle la photo-numérique diffère en nature de la photo-argentique.
Cette rupture du lien physique et énergétique entre les choses et les images équivaut à une rupture du régime de l’empreinte institué par la photographie au milieu du xixe siècle.
L’ère du numérique sonne la fin de l’époque bénie que Roland Barthes a décrite comme celle où « le référent adhère » aux images photographiques, où chaque scène ou chose figurée « a été » avant de venir s’inscrire et se fixer sous la forme d’une empreinte de temps et d’espace dans la matière précieuse des images d’argent. Époque bénie, donc, où les images figuraient en fixant, en isolant, en sacralisant et, en quelque sorte, en édifiant des monuments iconiques aux choses. Époque bénie, enfin, où cet appareillage (technique) et cet apparat (esthétique) de l’enregistrement par contact des apparences supportaient un puissant régime de vérité.
Dès lors que les enregistrements numériques sont langagiers, la rigidité des images se dissout dans une ductilité infinie. Alors que la retouche était un tabou de la photo-argentique, un acte de lèse-vérité, elle est devenue l’état ordinaire de la photo-numérique au travers des logiciels de traitement d’images qui sont livrés avec les appareils… En termes deleuzien : la photo-argentique fonctionne sur le mode du « moule » (une forme fixe générant une série d’occurrences identiques) tandis que la photo-numérique ressortit, elle, à la « modulation » - chaque image étant emportée dans les devenirs de ses infinies transformations et variations.
En pratique, les images numériques se caractérisent par une perte d’origine, par une dissolution du référent, par une sorte de détachement du monde. Quant aux spectateurs, ils assistent à un devenir-image du monde et à l’avènement d’un tout autre régime de vérité - l’ère numérique devenant l’ère du doute, l’envers de l’époque des illusions de vérité qui était accrochée aux photo-argentiques. Un vrai doute succède ainsi à une fausse certitude de vérité.
Si le matériau logico-langagier de la photo-numérique brise le lien matériel entre les images et les choses qu’avait noué la photo-argentique, si donc il fait vaciller l’ancien règne de l’empreinte, il est celui par lequel s’édifie l’ère numérique des sociétés d’aujourd’hui. En apparence si peu matériel, ce matériau a pourtant une matérialité, celle d’un langage, qui est assez forte pour ouvrir une nouvelle ère dans la culture et la civilisation, et, accessoirement, pour nous inciter à renoncer à la fausse et trompeuse notion de « dématérialisation » du monde. Aussi ténue tactilement soit-elle, une autre matière n’est pas une absence de matière, mais une version différente de la matière iconique.
La photo-numérique rompt l’homogénéité de matière entre les choses et les images qui, dans la photo-argentique, était assurée par la lumière et les sels d’argent. Un contact physique a bien lieu entre les choses et le dispositif numérique de saisie, mais il ne s’accompagne plus d’un échange énergétique entre les choses et les images. La transformation ne s’opère plus de chose à chose, des choses du monde à des images-choses, mais de chose à image-langage.
On passe du monde chimique et énergétique des choses et de la lumière au monde logico-langagier des images numériques. L’ancienne continuité matérielle entre la chose et son image argentique est brisée au profit d’une conversion de la matière en langage - autrement dit, au profit d’une virtualisation. C’est donc dès l’étape de la saisie que s’opère la rupture du lien physique et énergétique, rupture qui fonde l’altérité essentielle par laquelle la photo-numérique diffère en nature de la photo-argentique.
Cette rupture du lien physique et énergétique entre les choses et les images équivaut à une rupture du régime de l’empreinte institué par la photographie au milieu du xixe siècle.
L’ère du numérique sonne la fin de l’époque bénie que Roland Barthes a décrite comme celle où « le référent adhère » aux images photographiques, où chaque scène ou chose figurée « a été » avant de venir s’inscrire et se fixer sous la forme d’une empreinte de temps et d’espace dans la matière précieuse des images d’argent. Époque bénie, donc, où les images figuraient en fixant, en isolant, en sacralisant et, en quelque sorte, en édifiant des monuments iconiques aux choses. Époque bénie, enfin, où cet appareillage (technique) et cet apparat (esthétique) de l’enregistrement par contact des apparences supportaient un puissant régime de vérité.
Dès lors que les enregistrements numériques sont langagiers, la rigidité des images se dissout dans une ductilité infinie. Alors que la retouche était un tabou de la photo-argentique, un acte de lèse-vérité, elle est devenue l’état ordinaire de la photo-numérique au travers des logiciels de traitement d’images qui sont livrés avec les appareils… En termes deleuzien : la photo-argentique fonctionne sur le mode du « moule » (une forme fixe générant une série d’occurrences identiques) tandis que la photo-numérique ressortit, elle, à la « modulation » - chaque image étant emportée dans les devenirs de ses infinies transformations et variations.
En pratique, les images numériques se caractérisent par une perte d’origine, par une dissolution du référent, par une sorte de détachement du monde. Quant aux spectateurs, ils assistent à un devenir-image du monde et à l’avènement d’un tout autre régime de vérité - l’ère numérique devenant l’ère du doute, l’envers de l’époque des illusions de vérité qui était accrochée aux photo-argentiques. Un vrai doute succède ainsi à une fausse certitude de vérité.
Si le matériau logico-langagier de la photo-numérique brise le lien matériel entre les images et les choses qu’avait noué la photo-argentique, si donc il fait vaciller l’ancien règne de l’empreinte, il est celui par lequel s’édifie l’ère numérique des sociétés d’aujourd’hui. En apparence si peu matériel, ce matériau a pourtant une matérialité, celle d’un langage, qui est assez forte pour ouvrir une nouvelle ère dans la culture et la civilisation, et, accessoirement, pour nous inciter à renoncer à la fausse et trompeuse notion de « dématérialisation » du monde. Aussi ténue tactilement soit-elle, une autre matière n’est pas une absence de matière, mais une version différente de la matière iconique.
André Rouillé, Quand la photographie cesse d’en être, De l’argentique au numérique
Sunday, May 27, 2012
Phébus
PHÉBUS, subst. masc.
Littér., vieilli. Style obscur, ampoulé et alambiqué. Donner dans le phébus. Les reproches que l'on a faits au style, au sujet et à l'effet du livre (galimatias, phébus, caractères ridicules, péril pour les moeurs et la religion, profanation, scandale) (Chateaubr., Martyrs, t.1, 1810, p.68). Il refit la déclaration d'amour du galant comme froide, prétentieuse, guindée et sentant son phébus (Gautier, Fracasse, 1863, p.261).
♦ Diseur de phébus. Écrivain ou orateur au langage obscur et alambiqué. C'est un esprit des plus confus, alambiqué, ce que nos pères appelaient un diseur de phébus et qui rend encore plus déplaisantes, par sa façon de les énoncer, les choses qu'il dit (Proust, J. filles en fleurs, 1918, p.474).
Étymol. et Hist. 1609 parler phoebus «s'exprimer dans un style poétique élevé» (Régnier, Satires, éd. G. Raibaud, XI, p.151); 1633 Donner sur le phoebus «tomber dans un style obscur et affecté» (Corneille, Mélite, I, 1); 1661 phoebus (le) «style, langage obscur, affecté» (Molière, École des maris, III, 2), 1671 phebus (D. Bouhours, Les Entretiens d'Ariste et d'Eugène, Paris, Mabre-Cramoisy, p.61). Empl. comme nom commun de Phebus (1544, «le soleil», M. Scève, Délie, éd. Parturier, p.156), «autre nom d'Apollon, dieu du soleil et de la poésie», lat. Phoebus «id.», gr. Φ ο ι ̃ β ο ς «le brillant, surnom d'Apollon».
♦ Diseur de phébus. Écrivain ou orateur au langage obscur et alambiqué. C'est un esprit des plus confus, alambiqué, ce que nos pères appelaient un diseur de phébus et qui rend encore plus déplaisantes, par sa façon de les énoncer, les choses qu'il dit (Proust, J. filles en fleurs, 1918, p.474).
Étymol. et Hist. 1609 parler phoebus «s'exprimer dans un style poétique élevé» (Régnier, Satires, éd. G. Raibaud, XI, p.151); 1633 Donner sur le phoebus «tomber dans un style obscur et affecté» (Corneille, Mélite, I, 1); 1661 phoebus (le) «style, langage obscur, affecté» (Molière, École des maris, III, 2), 1671 phebus (D. Bouhours, Les Entretiens d'Ariste et d'Eugène, Paris, Mabre-Cramoisy, p.61). Empl. comme nom commun de Phebus (1544, «le soleil», M. Scève, Délie, éd. Parturier, p.156), «autre nom d'Apollon, dieu du soleil et de la poésie», lat. Phoebus «id.», gr. Φ ο ι ̃ β ο ς «le brillant, surnom d'Apollon».
Friday, May 25, 2012
Alors, que penses-tu de ce Moyen Age ?
Je suis fasciné par les changements que nous vivons actuellement. Qui aurait pu prédire les transformations qui ont commencé en Afrique du Nord ? A partir de là, les bouleversements se sont propagés dans une bonne partie de l'Europe et aux Etats-Unis, où beaucoup de mes étudiants me disent : "Je suis médecin et je ne trouve pas de travail." Ou encore : "Mon père a réussi à intégrer la classe moyenne et j'ai l'impression de redescendre vers la classe ouvrière." En Amérique latine, des changements considérables sont également en cours, même si la situation reste relativement stable. Auparavant, les problèmes commençaient en Amérique latine. Maintenant, on dirait qu'ils vont arriver jusque-là. Et c'est un monde que nous ne savons pas comment qualifier. Si l'on demandait à Dante : "Alors, que penses-tu de ce Moyen Age ?", il répondrait : "Qu'est-ce que le Moyen Age ?" Notre époque n'a pas de nom, mais nous avons conscience que tout est en train de changer. A la Renaissance, on savait que c'était la Renaissance ; au Moyen Age, on ne savait pas qu'on était au Moyen Age.
Carlos Fuentes | "No tengo ningún miedo literario"
Je ne suis pas d’accord avec vous
Voltaire n’a jamais écrit « je ne suis pas d’accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu’au bout pour que vous puissiez le dire » ! Il ne l’a même jamais dit. A l’origine de cette formule, une Britannique, Evelyn Beatrice Hall qui, dans un ouvrage consacré à Voltaire en 1906, lui attribue le célèbre « I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it ». Charles Wirz, le conservateur du musée Voltaire de Genève, confirme que le philosophe n’a jamais rien dit de tel et présente même l’aveu d’Evelyn Beatrice Hall : « Je ne suis pas d’accord avec vous [...] est ma propre expression et n’aurait pas dû être mise entre guillemets. » Dans son « The Friends of Voltaire », Evelyne Beatrice Hall a tenté ainsi de résumer la pensée de Voltaire, notamment au moment de sa prise de position dans l’affaire Helvétius, l’un des philosophes qui contribua à L’Encyclopédie. Son livre, « De l’Esprit », irrite profondément Voltaire – il qualifie le texte de « fatras d’Helvétius » dans une lettre à de Brosses du 23 septembre 1758, citée par Gerhardt Stenger – mais lui apporte son soutien face aux attaques virulentes dont il est victime après la parution de son ouvrage. Dans ce contexte, la phrase prêtée à Voltaire ne paraît pas dépasser sa pensée. Pourtant, plusieurs amoureux de l’écrivain s’émeuvent de l’utilisation qui en est faite.
Zineb Dryef | Journaliste
Zineb Dryef | Journaliste
Thursday, May 24, 2012
Le monde paraissait froid
Au-dehors, même à travers le carreau de la fenêtre fermée, le monde paraissait froid. Dans la rue, de petits remous de vent faisaient tourner en spirale la poussière et le papier déchiré. Bien que le soleil brillât et que le ciel fût d’un bleu dur, tout semblait décoloré, hormis les affiches collées partout. De tous les carrefours importants, le visage à la moustache noire vous fixait du regard. Il y en avait un sur le mur d’en face. BIG BROTHER VOUS REGARDE, répétait la légende, tandis que le regard des yeux noirs pénétrait les yeux de Winston. Au niveau de la rue, une autre affiche, dont un angle était déchiré, battait par à-coups dans le vent, couvrant et découvrant alternativement un seul mot : ANGSOC. Au loin, un hélicoptère glissa entre les toits, plana un moment, telle une mouche bleue, puis repartit comme une flèche, dans un vol courbe. C’était une patrouille qui venait mettre le nez aux fenêtres des gens. Mais les patrouilles n’avaient pas d’importance. Seule comptait la Police de la Pensée.
George Orwell, 1984
Friday, April 27, 2012
Ils veulent voir leur nom sur la couverture d’un livre
Beaucoup de gens ne veulent pas écrire ; ils veulent avoir écrit. En d’autres termes, ils veulent voir leur nom sur la couverture d’un livre et leur photo au dos, avec un joli sourire. Mais ça, c’est ce qui arrive à la fin, quand on a fini son boulot, pas au début. Pour en arriver là, vous devez être disposé à y renoncer, à vous dire qu’il se peut que ça n’arrive tout simplement jamais, et que ça vous est à peu près égal, parce que ce qui compte pour vous, c’est d’écrire. Ce qui est vraiment important, c’est le mystère, la magie des mots qu’on met sur le papier. Si ce n’est pas ce que vous pensez, alors vous ne voulez pas être écrivain, ce que vous voulez, c’est seulement être un auteur. […] Les auteurs décrètent dès le début de leur carrière que s’ils ne sont pas publiés, ils laisseront tomber. Alors que les écrivains, ce sont des gens qui écrivent et qui écriront toujours, quoi qu’il arrive : ils respirent, non ? Ils ne peuvent pas faire autrement. Il faut bien qu’ils vivent.
Elizabeth George, Mes Secrets d’écrivain
Elizabeth George, Mes Secrets d’écrivain
L’image de l’écrivain génial
Un roman, une nouvelle, un poème, ne sont jamais un premier jet. La volonté du mot juste, la recherche du rythme parfait, de la sonorité exacte, de la cohérence d’un personnage, d’une scène, provoquent des ajouts, des variations, des suppressions, des retours. La recherche dans ses souvenirs, dans ses connaissances, dans ses références, dans son imaginaire, dans les livres, dans les dictionnaires (synonymes, définitions, rimes, analogies, symboles…), l’idée qui surgit quand on ne l’attend pas et qu’il faut noter, tout cela fait partie du travail d’écriture. La cohérence dans un roman ne peut se faire qu’au prix d’un travail scrupuleux d’écriture, de relectures, de ré-écritures.
L’image de l’écrivain génial, flamboyant, qui écrit tout en une seule fois, reste une fantaisie romantique. Claude Simon avait coutume de dire que s’il ne se mettait pas à sa table de travail, rien ne se faisait ; en ce sens l’inspiration pour lui n’existe pas. L’écriture, loin d’être un acte inspiré, chaotique, une passion dévorante, est un véritable travail, une construction réfléchie mûrement qui ne laisse rien au hasard.
— Wikipedia “Ecriture”
L’image de l’écrivain génial, flamboyant, qui écrit tout en une seule fois, reste une fantaisie romantique. Claude Simon avait coutume de dire que s’il ne se mettait pas à sa table de travail, rien ne se faisait ; en ce sens l’inspiration pour lui n’existe pas. L’écriture, loin d’être un acte inspiré, chaotique, une passion dévorante, est un véritable travail, une construction réfléchie mûrement qui ne laisse rien au hasard.
— Wikipedia “Ecriture”
Thursday, April 26, 2012
Tu as encore ton libre-arbitre
Dans quel état est le Liban ? Lamentable à tous les niveaux, notamment au niveau gouvernemental et de l'Etat. Mais j’oserais dire qu’on est habitué à vivre dans cette merde, on s’en arrange très bien. Les amis qui viennent sont toujours sidérés de voir comment on arrive à vivre dans ce foutoir. Mais en même temps, on n’a pas Hadopi, on télécharge gratuitement, tu peux acheter n’importe quel nouveau programme pour 1$. Tu peux fuir les impôts sans problème, tout le monde s’en fout. De toute façon, la corruption passe au-dessus de tout ça. C’est des petites conneries qui contrebalancent la merde dans laquelle on vit et qui font qu’on est bien content de vivre là-bas. C’est bien sûr affreux, la corruption dans l’Etat. Mais d'un côté, la vie de tous les jours est un peu moins prise de tête qu’en Europe. Si à trois heures du matin tu arrives à un feu rouge et qu’il n’y a personne, tu peux passer. Même s’il y a un policier. Tu as encore ton libre-arbitre. Mais, on vit aussi dans un état d’entre-deux-guerres. On ne sait pas d’où elle va venir : est-ce que c’est d’Israël ? Est-ce que c’est une guerre civile ? Il y a plein de scénarios possibles et ça, c’est dur. Depuis qu’on est jeune, au Liban, on a appris à ne pas faire de projets à long terme. Dans trois ans, il y a de fortes chances que tu ne sois plus ici ou que tu ne sois plus du tout. C’est une vie au jour le jour et je m’en arrange très bien. Quand j'étais plus jeune, je voulais venir en France ou en Belgique, dans un pays francophone où j’aurais pu faire de la bande dessinée. Mais en voyageant avec les tournées de musique, j’ai découvert que ça n'est pas mieux ailleurs. Bien sûr ici il y a des subventions pour la culture, il n’y a pas de guerre. Mais en contrepartie, il y a aussi de moins bonnes choses.
Mazen Kerbaj, Gens de Beyrouth - gens de Paris
Mazen Kerbaj, Gens de Beyrouth - gens de Paris
Tuesday, April 17, 2012
Sunday, April 15, 2012
Friday, April 13, 2012
Thursday, April 12, 2012
Les six portes d'Alger
Au XVIe siècle la ville a 6 portes ouvertes et quelques autres murées. Les deux principales communiquent par une rue longue de 1200 pas. Celle qui est à l'orient s'appelle Babason, où on exécute les Turcs criminels qu'on pend à un crochet attaché aux murailles de la ville, et celle qui est à l'occident Babalouette, lieu où l'on fait justice aux chrétiens. La 3ème porte s'appelle La Nouvelle Porte, aussi située vers l'orient du côté qui mène au château de l'Empereur. La 4ème est la porte d'Alcassava, qui est tout contre un château du même nom. La 5ème, qui regarde vers la mer, s'appelle la porte du Môle ou la porte du Divan. La 6ème s'appelle la porte de la Piscaderie. À chacune de ces portes il y a 3 ou 4 Turcs qui ont des bâtons à la main, dont ils frappent sur les épaules des esclaves qui passent pour se divertir.
Olfert Dapper
Olfert Dapper
Wednesday, April 11, 2012
Monday, April 2, 2012
Contraint de s'exprimer
Le narcissisme est une notion à prendre avec des pincettes. Il ne renvoie pas dans l'époque contemporaine à une cause intérieure, psychologique, mais plutôt extérieure, liée aux conditions sociales actuelles. Faute de structure familiale solide, notamment, nous donnons actuellement peu d'outils aux jeunes pour devenir des individus. Ils sont sommés de passer toujours plus vite à l'âge adulte, sans l'assurance ni l'estime de soi qui accompagnent cette transition. Le narcissisme qui s'exprime sur Internet reflète plutôt le côté non réalisé d'un individu en quête de lui-même. Celui-ci est pourtant contraint de s'exprimer, de se rendre visible, de dire beaucoup sur sa propre personne, sans quoi il sera mis à l'écart.
Olivier Voirol, chercheur au Laboratoire de sociologie de l'Université de Lausanne
Olivier Voirol, chercheur au Laboratoire de sociologie de l'Université de Lausanne
Wednesday, March 28, 2012
La capacité créative
La capacité créative repose, selon Max Turner, sur l’analogie qui consiste à trouver des ressemblances cachées entre des éléments apparemment disparates. La pensée analogique serait l’un des piliers de la créativité (en art et en science).
L'abduction
Charles Pierce considérait l'abduction comme la seule forme de raisonnement permettant de découvrir quelque chose de nouveau : "L'abduction suggère simplement que quelque chose peut être ; la déduction prouve que quelque chose doit être ; l'induction montre que quelque chose est réellement opératoire".
Friday, March 23, 2012
Friday, March 2, 2012
La théorie de la vitre brisée
La théorie de la vitre brisée (broken windows theory) est une analyse criminologique développée aux États-Unis au début des années 1980, qui soutient que les petites détériorations que subit l’espace public suscitent nécessairement un délabrement plus général des cadres de vie et des situations humaines qui y sont liées. Dans une rue, si la vitre d’une usine ou d’un bureau est cassée et n’est pas réparée, le passant conclut que personne ne s’en préoccupe. Bientôt toutes les vitres seront cassées et le passant pensera alors, non seulement que personne n’est en charge de l’immeuble, mais que personne n’est responsable de la rue où il se trouve, ce qui constitue l’amorce d’un cercle vicieux. Finalement, il y aura de moins en moins de passants dans les rues. Cette théorie a souvent été utilisée par les partisans de la tolérance zéro alors que l’expérience avait pour but de démontrer que lorsque les régulations sociales informelles font défaut, les comportements destructeurs se libèrent, quelles que soient les couches sociales concernées. D’où l’importance de remplacer très vite la première vitre cassée, ce qui évite de voir tomber les suivantes…
Scriptopolis
Scriptopolis
Saturday, February 25, 2012
Précisionnisme
précisionnisme [nom masculin] : Tendance de la peinture figurative des États-Unis dans les années 1920 et 1930, caractérisée par un style schématique et précis (Sheeler, Charles Demuth [1883-1935], O'Keeffe pour une part de son œuvre, etc.). [Également appelés « réalistes-cubistes » ou « Immaculés », les précisionnistes ont privilégié la représentation du paysage urbain et industriel moderne.]
Precisionism ou "immaculates"
Nom donné à l'esthétique d'un groupe (que l'on appelle aussi Cubo-Realism, en franç., réalistes-cubistes) d'artistes américains formé à la suite de l'exposition de l'Armory Show à New York en 1913. Ces artistes cherchèrent, tout au long de leur carrière, à adapter les réalités de la "vie américaine" aux qualités formelles qu'ils discernaient surtout dans la peinture cubiste. Charles Demuth fut le premier à se soumettre spontanément à cette réforme visuelle. Avant 1917, il avait déjà modifié son style pour soumettre l'architecture des villes américaines aux angles aigus et aux plans transparents du Cubisme. Charles Sheeler s'intéressa aussi à la structure fondamentale des objets, libérant le sujet de son côté anecdotique et romantique pour n'en retenir que les aspects essentiels, mais tout en conservant des références visibles. Ces peintres avaient appris que leurs collègues français regardaient les États-Unis avec admiration, comme s'ils étaient l'expression du modernisme industriel, la réalisation même de la beauté du XXe s. Ils en vinrent à concentrer leur effort artistique sur l'activité contemporaine industrielle ou urbaine. Cependant, dans les limites de ce style, des artistes comme Georgia O'Keefe, qui simplifiaient et idéalisaient les formes organiques offertes par la nature, eurent également du succès. Niles Spencer, George Ault, Ralston Crawford, avec Demuth, Sheeler et O'Keefe, les meilleurs du groupe des réalistes-cubistes, tentèrent la mise à jour d'une beauté exclusivement moderne en acceptant les qualités extérieures de la peinture française et les réalités des apparences américaines. En fait, leur notion du terme abstrait était littérale. Ils cherchaient des principes généraux, clairs, articulés, emphatiques dans leur structure et qui, pourtant, préservaient l'intégrité du sujet typique américain.
Precisionism ou "immaculates"
Nom donné à l'esthétique d'un groupe (que l'on appelle aussi Cubo-Realism, en franç., réalistes-cubistes) d'artistes américains formé à la suite de l'exposition de l'Armory Show à New York en 1913. Ces artistes cherchèrent, tout au long de leur carrière, à adapter les réalités de la "vie américaine" aux qualités formelles qu'ils discernaient surtout dans la peinture cubiste. Charles Demuth fut le premier à se soumettre spontanément à cette réforme visuelle. Avant 1917, il avait déjà modifié son style pour soumettre l'architecture des villes américaines aux angles aigus et aux plans transparents du Cubisme. Charles Sheeler s'intéressa aussi à la structure fondamentale des objets, libérant le sujet de son côté anecdotique et romantique pour n'en retenir que les aspects essentiels, mais tout en conservant des références visibles. Ces peintres avaient appris que leurs collègues français regardaient les États-Unis avec admiration, comme s'ils étaient l'expression du modernisme industriel, la réalisation même de la beauté du XXe s. Ils en vinrent à concentrer leur effort artistique sur l'activité contemporaine industrielle ou urbaine. Cependant, dans les limites de ce style, des artistes comme Georgia O'Keefe, qui simplifiaient et idéalisaient les formes organiques offertes par la nature, eurent également du succès. Niles Spencer, George Ault, Ralston Crawford, avec Demuth, Sheeler et O'Keefe, les meilleurs du groupe des réalistes-cubistes, tentèrent la mise à jour d'une beauté exclusivement moderne en acceptant les qualités extérieures de la peinture française et les réalités des apparences américaines. En fait, leur notion du terme abstrait était littérale. Ils cherchaient des principes généraux, clairs, articulés, emphatiques dans leur structure et qui, pourtant, préservaient l'intégrité du sujet typique américain.
Subscribe to:
Comments (Atom)