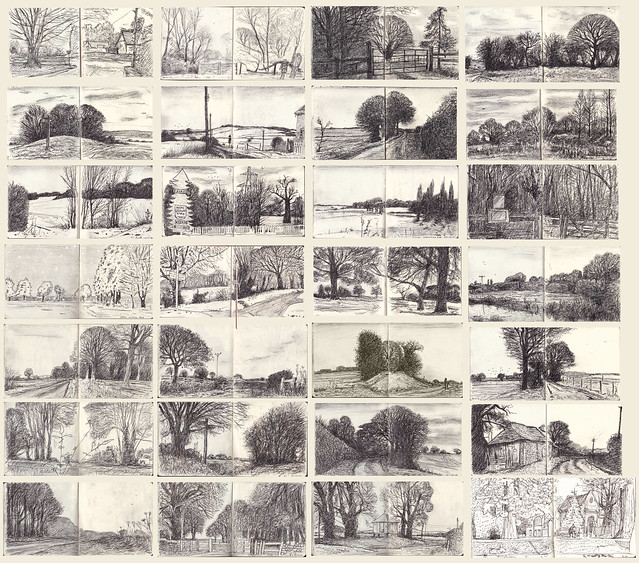Tuesday, December 25, 2012
Saturday, December 8, 2012
La philosophie du porc
C'est sous la conjonction de la terreur politique, de la faiblesse des élites et de la séduction du profit que le monde des intérêts et des possessions matérielles, qui s'est peu à peu développé à partir des années 1980, a totalement remplacé les rêves spirituels et les fondations morales comme éléments dominants de l'âme. La philosophie du porc, caractérisée par la polarisation sur l'économie et la primauté de l'intérêt, a entamé, sous prétexte d'introspection, une critique du radicalisme et l'élimination de l'idéalisme. La froideur de la "localisation" et du retour à l'académique a remplacé l'enthousiasme pour les idées libérales ; et même l'extrême moralisme de ce que l'on a qualifié de "littérature de résistance", dont l'objectif est de résister à la culture de masse, tout, sans exception, a pour prémisse la collaboration avec le système existant. Que ce soit du point de vue de la renaissance ou de la reconstruction de la culture nationale, ou du point de vue du renforcement ou de l'élévation de l'universalisme et de la nature humaine, la Chine des années 1990 est affreuse et pourrie, et la médiocrité en est devenue le symbole évident.
Liu Xiaobo, La philosophie du porc et autres essais
Thursday, December 6, 2012
Qu'est-ce que la bêtise ?
Quelqu'un qui entreprend de parler de la bêtise court aujourd'hui le risque de subir quelque avanie : on peut l'accuser de prétention, ou de vouloir troubler le cours de l'évolution historique. J'ai écrit moi-même, il y a quelques années déjà : « Si la bêtise ne ressemblait pas à s'y méprendre au progrès, au talent, à l'espoir et au perfectionnement, personne ne voudrait être bête. » C'était en 1931 ; et nul ne s'avisera de contester que le monde, depuis, n'ait vu un certain nombre de progrès et de perfectionnements ! Ainsi est-il devenu peu à peu impossible d'ajourner la question : « Qu'est-ce, au juste, que la bêtise ? » [...] Nous ne pouvons nous faire quelque idée du pouvoir, énorme autant qu'éhonté, de la bêtise sur nous, en voyant l'aimable conspiration de surprise qui accueille généralement celui qui prétend, alors qu'on lui faisait confiance, évoquer ce monstre par son nom. J'ai commencé par en faire sur moi l'expérience ; je n'ai pas tardé à en avoir la confirmation historique le jour où, parti à la recherche de prédécesseurs dans l'étude de la bêtise — dont je n'ai rencontré qu'un petit nombre d'ailleurs, les sages préférant apparemment traiter de la sagesse ! —, j'ai reçu d'un érudit de mes amis le texte d'une conférence de 1868 dont l'auteur est Jon. Ed. Erdman, élève de Hegel et professeur à Halle. Cette conférence, intitulée De la bêtise, commence en effet par évoquer les rires qui avaient salué son annonce ; et depuis je sais que même un hégélien peut y être exposé, je suis convaincu qu'il y a quelque chose de particulier dans cette attitude de l'homme envers celui qui veut traiter de la bêtise ; et la certitude d'avoir ainsi provoqué un pouvoir psychologique puissant et profondément ambigu me remplit de perplexité. Je préfère donc avouer ma faiblesse devant ce problème : c'est que j'ignore ce quelle est. Je n'ai pas découvert de théorie de la bêtise à l'aide de laquelle je pourrais entreprendre de sauver le monde ; je n'ai même pas trouvé, à l'intérieur des limites de la réserve scientifique, un seul chercheur qui en ai fait son objet, pas même le témoignage d'une unanimité qui se serait établie tant bien que mal à son sujet dans l'analyse de phénomènes analogues. Peut-être cela tient-il à mon manque d'information ; mais il est plus probable que la question : « Qu'est-ce que la bêtise ? » est aussi peu naturelle à la pensée moderne que la question : « Qu'est-ce que le beau, ou le bien, ou l’électricité ? ».
Robert Musil, De la bêtise, conférence de Vienne, 11 mars 1937.
Effigie du raté
Ayant tout acte en horreur, il se répète à lui-même : « Le mouvement, quelle sottise ! » Ce ne sont pas tant les événements qui l'irritent que l'idée d'y prendre part ; et il ne s'agite que pour s'en détourner. Ses ricanements ont dévasté la vie avant qu'il n'en ait épuisé la sève. C'est un Ecclésiaste de carrefour, qui puise dans l'universelle insignifiance une excuse à ses défaites. Soucieux de trouver sans importance quoi que ce soit, il y réussit aisément, les évidences étant en foule de son côté. Dans la bataille des arguments, il est toujours vainqueur, comme il est toujours vaincu dans l'action : il a "raison", il rejette tout et tout le rejette. Il a compris prématurément ce qu'il ne faut pas comprendre pour vivre et comme son talent était trop éclairé sur ses propres fonctions, il l'a gaspillé de peur qu'il ne s'écoulât dans la niaiserie d'une oeuvre. Portant l'image de ce qu'il eût pu être comme un stigmate et comme un nimbe, il rougit et se flatte de l'excellence de sa stérilité, à jamais étranger aux séductions naïves, seul affranchi parmi les ilotes du Temps. Il extrait sa liberté de l'immensité de ses inaccomplissements ; c'est un dieu infini et pitoyable qu'aucune création ne limite, qu'aucune créature n'adore, et que personne n'épargne. Le mépris qu'il a déversé sur les autres, les autres le lui rendent. Il n'expie que les actes qu'il n'a pas effectués, dont pourtant le nombre excède le calcul de son orgueil meurtri. Mais à la fin, en guise de consolation, et au bout d'une vie sans titres, il porte son inutilité comme une couronne.
« A quoi bon ? » adage du Raté, d'un complaisant de la mort... Quel stimulant lorsqu'on commence à en subir la hantise ! Car la mort, avant de trop nous y appesantir, nous enrichit, nos forces s'accroissent à son contact ; puis, elle exerce sur nous son oeuvre de destruction. L'évidence de l'inutilité de tout effort, et cette sensation de cadavre futur s'érigeant déjà dans le présent, et emplissant l'horizon du temps, finissent par engourdir nos idées, nos espoirs et nos muscles, de sorte que le surcroît d'élan suscité par la toute récente obsession, se convertit — lorsque celle-ci s'est implantée irrévocablement dans l'esprit — en une stagnation de notre vitalité. Ainsi cette obsession nous incite à devenir tout et rien. Normalement elle devrait nous mettre devant le seul choix possible : le couvent ou le cabaret. Mais, quand nous ne pouvons la fuir ni par l'éternité ni par les plaisirs, quand, harcelés au milieu de notre vie, nous sommes aussi loin du ciel que de la vulgarité, elle nous transforme en cette espèce de héros décomposés qui promettent tout et n'accomplissent rien : oisifs s'essoufflant dans le Vide, charognes verticales, dont la seule activité se réduit à penser qu'ils cesseront d'être...
Emil Cioran, Syllogismes de l'amertume
Thursday, November 29, 2012
Ce que nous appelons symbole
Ce que nous appelons symbole est un terme, un nom ou une image, qui même lorsqu’ils nous sont familiers dans la vie quotidienne, possèdent néanmoins des implications, qui s’ajoutent à leur signification conventionnelle et évidente. Le symbole implique quelque chose de vague, d’inconnu ou de caché pour nous… Lorsque l’esprit entreprend l’exploration d’un symbole, il est amené à des idées qui se situent au-delà de ce que notre raison peut saisir. L’image de la roue peut, par exemple, nous suggérer le concept d’un soleil divin, mais à ce point notre raison est obligée de se déclarer incompétente, car l’homme est incapable de définir un être divin… C’est parce que d’innombrables choses se situent au-delà de l’entendement humain que nous utilisons constamment des termes symboliques pour représenter des concepts que nous ne pouvons ni définir ni comprendre pleinement… Mais cet usage conscient que nous faisons des symboles n’est qu’un aspect d’un fait psychologique de grande importance : car l’homme crée aussi des symboles de façon inconsciente et spontanée pour tenter d’exprimer l’invisible et l’ineffable.
Carl Gustav Jung
Wednesday, November 21, 2012
Actes respectueux ou actes de respect
Au XIXe siècle, la majorité matrimoniale était de 25 ans pour un homme et de 21 ans pour une femme.
Même plus âgés, les jeunes gens qui désiraient se marier pouvaient le faire sans le consentement de leurs parents, mais après avoir respecté la formalité suivante : ils devaient notifier leur projet aux parents par un acte notarié appelé « acte respectueux » ou « acte de respect ».
En cas de refus des parents, la demande devait être renouvelée deux fois. Si le garçon avait plus de 30 ans ou si la fille avait plus de 25 ans, un seul acte respectueux suffisait. Le mariage pouvait avoir lieu, un mois après le refus des parents.
Ces mesures ont été progressivement assouplies à la fin du XIXe siècle et ont été définitivement supprimées en 1933.
Même plus âgés, les jeunes gens qui désiraient se marier pouvaient le faire sans le consentement de leurs parents, mais après avoir respecté la formalité suivante : ils devaient notifier leur projet aux parents par un acte notarié appelé « acte respectueux » ou « acte de respect ».
En cas de refus des parents, la demande devait être renouvelée deux fois. Si le garçon avait plus de 30 ans ou si la fille avait plus de 25 ans, un seul acte respectueux suffisait. Le mariage pouvait avoir lieu, un mois après le refus des parents.
Ces mesures ont été progressivement assouplies à la fin du XIXe siècle et ont été définitivement supprimées en 1933.
Tuesday, November 20, 2012
Friday, November 16, 2012
L’œuvre de Deleuze
L’œuvre de Deleuze, on l’aime ou ne l’aime pas, on l’aime de façon un peu folle ou pour le moins exaltée ou on la déteste de façon tout aussi folle et exaltée, même s’il s’agit d’une exaltation rentrée. On peut également ignorer Deleuze, ce qui est malgré tout le cas du plus grand nombre. Mais c’est évidemment dommage. Pour ma part, lorsque j’ai commencé de le lire, il ne m’a plus été possible de m’arrêter. C’est un peu comme dans l’extrait du roman de Malamud que Deleuze cite au début de son petit livre sur Spinoza. Comme l’homme de Kiev découvrant Spinoza, en lisant Deleuze je ne comprenais pas tout, presque rien au début il faut bien le reconnaître, mais, effectivement, c’était comme si j’enfourchais un balai de sorcière, ou plus précisément comme si, sans comprendre, je comprenais, comme si j’avais la certitude que la compréhension précise ou de détail viendrait ensuite, alors même que tout ce que je lisais était clair et évident pour moi, à condition de ne pas s’arrêter, de continuer de lire, toujours plus et toujours plus loin. Un mouvement qui ne m’a plus quitté, qui m’a permis de relire ce que j’avais lu, de le comprendre un peu moins mal ; mais qui explique également le désarroi que j’ai éprouvé, comme beaucoup d’autres j’imagine, lorsque j’ai appris la mort de Deleuze, un désarroi en grande partie égoïste. Ce qui m’accablait c’était la certitude que je ne lirais plus jamais un nouveau livre de Deleuze.
Daniel Colson, Deleuze, Guattari et l’anarchie
Daniel Colson, Deleuze, Guattari et l’anarchie
Tuesday, November 13, 2012
Shucking and jiving
Shuck and jive se réfère à l'origine à des paroles et des actions trompeuses que les Africains-Américains utilisaient pour duper les Américains européens racistes ayant du pouvoir, à la fois pendant l'esclavage et après cette période. L'expression était couramment utilisée dans les années 1920, mais pourrait remonter à une époque plus lointaine. Shucking and jiving était une tactique de survie et de résistance. Un esclave, par exemple, pouvait dire avec enthousiasme : “bien sûr, Maître”, sans avoir réellement l’intention d'obéir. Ou bien un Africain-Américain pouvait faire semblant de travailler dur sur une tâche qu'on lui avait assignée, mais travaillait en réalité uniquement lorsqu'il était observé. Ces deux situations sont des cas de shucking and jiving.
Subscribe to:
Posts (Atom)